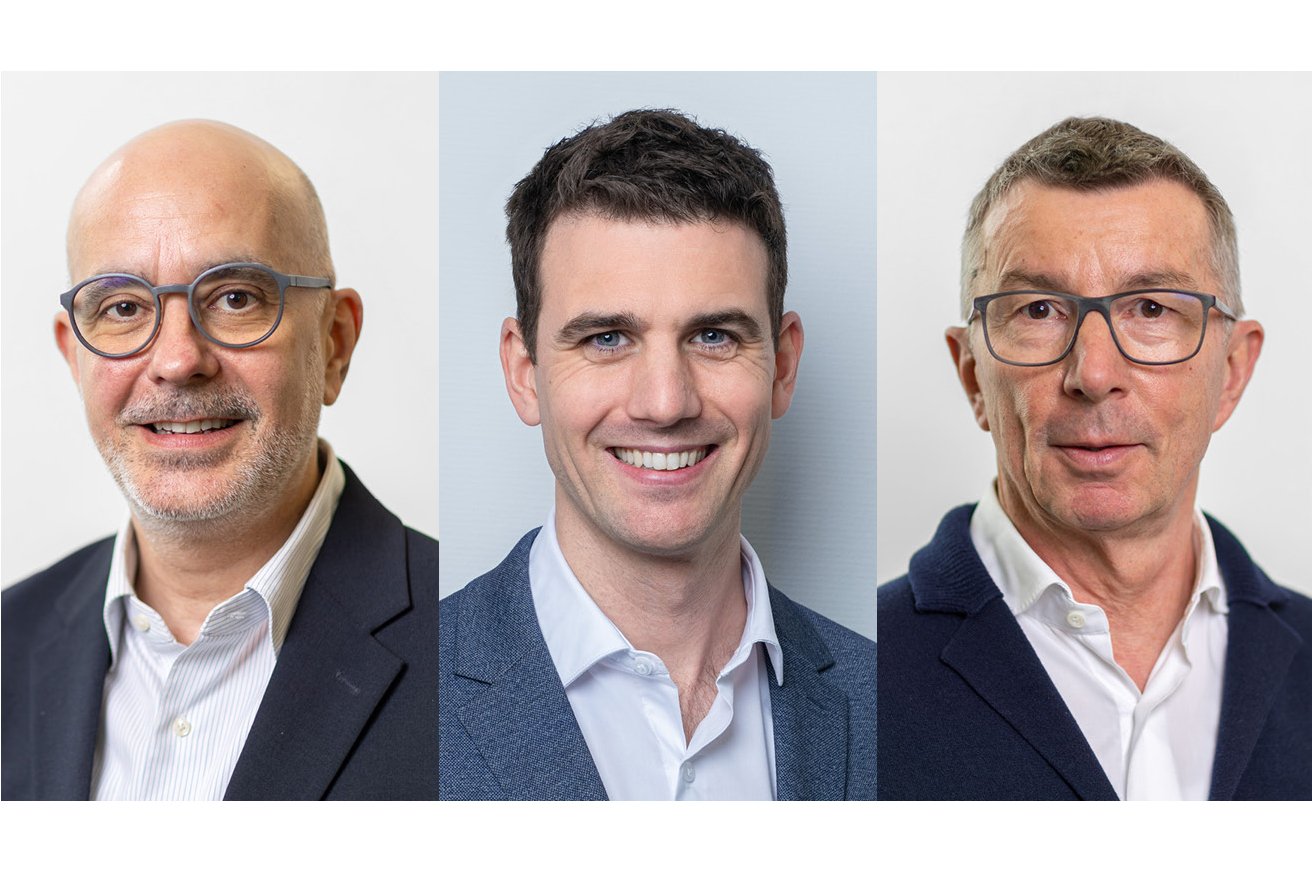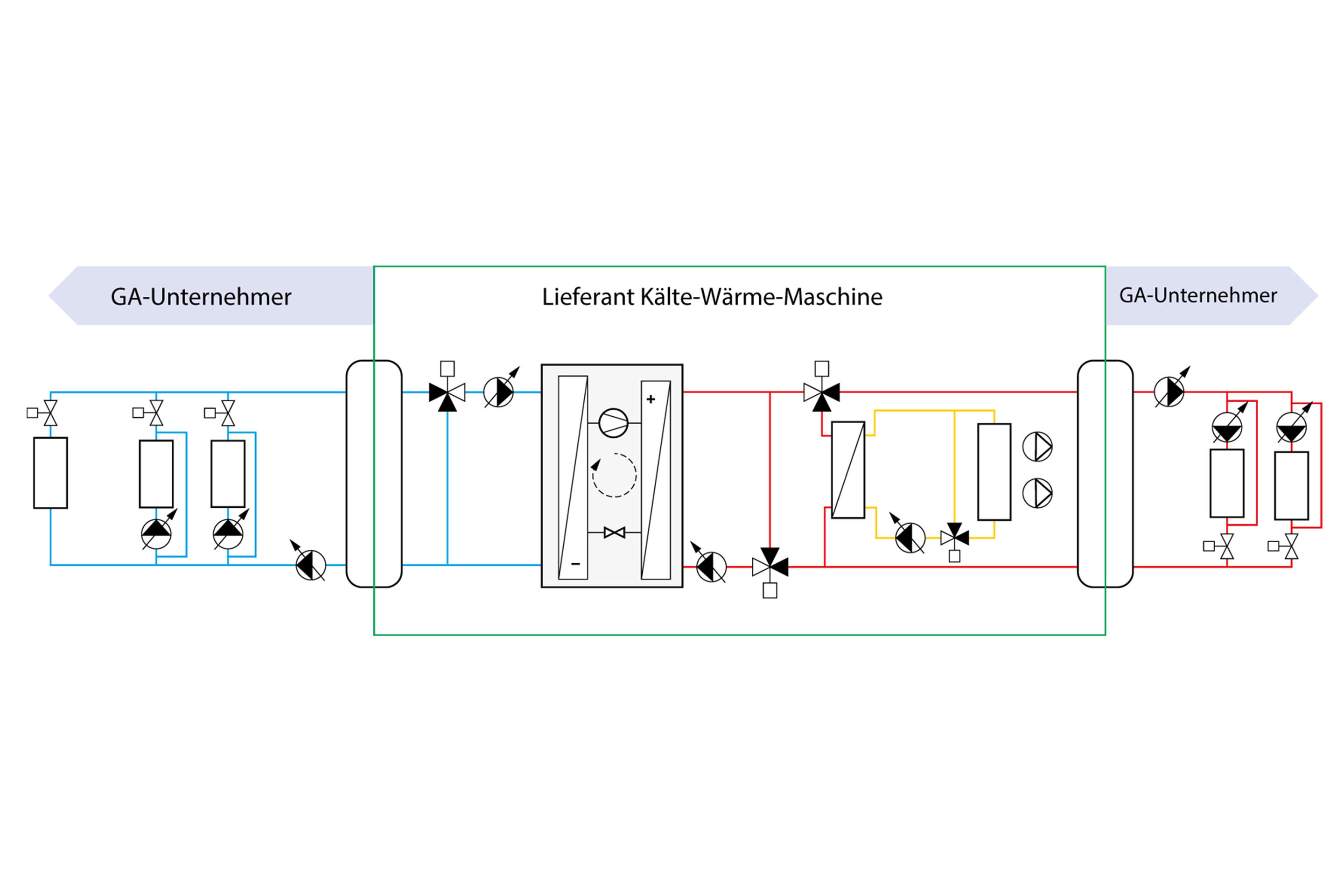Au service de la SIA
Trois nouveaux membres ont rejoint les rangs du Comité de la SIA: Matthias Gmür, Harry Gugger et Michael Roth. Chacun d’entre eux a bien voulu se confier en quelques mots sur ses raisons de s’engager au sein du Comité et sur ses ambitions pour la Société.
Avec le départ de Chris Luebkeman, Urs Rieder et Simone Tocchetti du Comité, la SIA s’est mise en quête de trois nouveaux noms pour les remplacer lors de l’Assemblée des délégués 2025 : l’un au sein du groupe professionnel Technique (BGT) et les deux autres au sein du groupe professionnel Architecture (BGA). Les délégués ont suivi les propositions de la commission de sélection et ont élu Matthias Gmür, Harry Gugger et Michael Roth au Comité début mai.
Matthias Gmür
À 37 ans, Matthias Gmür est ingénieur en environnement, mais aussi cofondateur et directeur général de la société s3 GmbH. Il s’engage activement au service de la SIA. Il n’a d’ailleurs pas tardé à reprendre la présidence du groupe professionnel Technique, un an seulement après son adhésion. Un mandat auquel il a désormais renoncé en rejoignant le Comité.
Votre présence au sein du Comité s’inscrit-elle dans le prolongement de votre présidence du BGT ?
Matthias Gmür: La présidence du BGT a été pour moi une expérience enrichissante, au cours de laquelle j’ai pu défendre les intérêts des métiers techniques, au sein de la SIA comme à l’extérieur, et expliquer les enjeux auxquels ils sont confrontés. Ce mandat au sein du Comité s’inscrit pour moi dans une suite logique. En effet, j’y vois la possibilité de défendre encore mieux les intérêts et les préoccupations du BGT au niveau de la Société et de participer activement au développement stratégique de la SIA. J’ai à cœur de favoriser les échanges entre les différents groupes professionnels et d’encourager la collaboration interdisciplinaire.
Y a-t-il des changements à apporter au fonctionnement de la SIA et, si oui, lesquels ?
La SIA est une organisation solide et riche d’une longue histoire, mais qui doit sans cesse se réinventer pour rester en phase avec son époque. J’aimerais que nous soyons encore plus ouverts aux nouvelles problématiques et aux innovations, notamment dans le domaine de la transition numérique et de la durabilité. Dans le même temps, nous devons resserrer les liens avec nos membres et favoriser le dialogue. Le changement n’est pas une fin en soi, mais une condition nécessaire pour faire face aux défis de demain.
Comment voyez-vous la branche de la construction et de la planification dans dix ans ?
Je suis sûr que, dans dix ans, la branche sera beaucoup plus durable, numérique et connectée. Des sujets comme l’économie circulaire, les énergies renouvelables ou les bâtiments intelligents occuperont une place encore plus grande. Dans le même temps, la collaboration entre les différentes disciplines revêt une importance croissante pour la mise au point de solutions globales. Les attentes auxquelles nous, les planificateurs, devons répondre se complexifient et en deviennent de plus en plus stimulantes.
Harry Gugger
La SIA a élu une sommité au sein de son Comité en la personne de Harry Gugger. Cet architecte âgé de 68 ans a travaillé comme partenaire au sein du cabinet Herzog & de Meuron pendant presque 20 ans, avant de fonder son propre bureau, Studio Gugger. Il a été professeur ordinaire à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) pendant 16 ans et lauréat du Prix Meret Oppenheim en 2004.
Monsieur Gugger, vous êtes à l’âge de la retraite, vous pourriez prendre du bon temps et profiter de la vie. Pourquoi vous engager pour la SIA ?
Harry Gugger: Je travaille toujours à mon bureau, certes, mais j’ai réglé ma succession et je n’exerce plus de responsabilités opérationnelles. Je ne suis pas vraiment à la retraite, mais j’apprécie de pouvoir me concentrer sur mes projets en cours. Mon statut de professeur honoraire me permet de jouir de certaines libertés et de m’engager au service de la SIA. Dans la mesure où la SIA m’a apporté un soutien décisif durant ma carrière, c’est une raison suffisante pour moi de rendre la pareille.
Vous êtes un architecte issu de l’école traditionnelle et vous avez longtemps travaillé dans la formation. À en juger par les mémoires de master des jeunes diplômé·es en architecture, la génération actuelle d’architectes accorde une plus grande importance à des aspects tels que les questions sociales et au rôle de l’architecte en soi. Dans ce contexte, comment la SIA doit-elle évoluer pour attirer les jeunes architectes ?
Même au niveau universitaire, la formation en architecture en Suisse s’est toujours distinguée par une forte orientation pratique. Nous avons formé nos étudiant·es à devenir des architectes, mais aussi des constructeurs. Ce choix a contribué à ancrer une forte culture du bâti dans la tradition suisse. Nous devons parvenir à montrer que la construction responsable n’est pas le problème, mais qu’elle peut, au contraire, aider à résoudre les problèmes actuels.
Comment la SIA doit-elle se mobiliser en faveur de la jeune génération de planificateurs ?
La SIA s’engage de longue date pour la promotion de la relève, notamment par son travail en faveur d’un système de concours bien structuré. Il faut mettre un frein à la complexité croissante des concours et simplifier les exigences de manière à donner une chance équitable aux jeunes architectes sans expérience. Et, bien sûr, nous devons élaborer au plus vite un règlement concernant les prestations et les honoraires qui soit de nature à garantir aux jeunes planificateurs des instructions simples et des revenus appropriés.
Michael Roth
Michael Roth, âgé de 54 ans, exerce lui aussi le métier d’architecte. Il est associé et copropriétaire du cabinet Diener & Diener Architekten, ainsi que membre du comité de la FAS (section de Bâle). Il se passionne pour des sujets majeurs, tels que la préservation d’une culture du bâti de qualité, une gestion respectueuse des ressources dans notre environnement bâti, la décarbonation des processus de construction ou encore la création de conditions de travail et d’adjudication équitables.
Monsieur Roth, le premier séminaire du Comité a eu lieu à la mi-juin. Quelle est votre première impression et comment voyez-vous votre rôle au sein du Comité ?
Michael Roth: L’atmosphère de travail au sein du Comité est très stimulante et tournée vers le progrès. Susanne Zenker, qui a pris ses fonctions de présidente il y a un an avec beaucoup d’enthousiasme, peut compter sur l’expérience des membres de longue date et sur la dynamique impulsée par les trois nouveaux élus pour affronter les défis qui nous attendent.
En tant que nouvel arrivant sans expérience préalable au sein de la SIA, je pense que mon rôle, dans un premier temps, consiste surtout à apporter un regard extérieur, un regard neuf qui pourra s’ajouter utilement aux points de vue existants et contribuer au développement futur.
Si vous pensez à l’avenir de la SIA, quels sont les champs d’action stratégiques qui réclament selon vous une action prioritaire et par où voudriez-vous commencer ?
Il me semble particulièrement important de donner plus de visibilité sociale et politique à nos positions. Si nous voulons renforcer l’influence de la SIA à l’intérieur comme à l’extérieur et, notamment, inciter les jeunes à s’impliquer activement dans l’association, il est essentiel de pouvoir s’appuyer à la fois sur une forte visibilité vis-à-vis de l’extérieur et sur une structure associative agile et tournée vers l’avenir.
Vous avez suivi une formation d’architecte traditionnelle. Or, le profil de la profession est en pleine mutation. La SIA, en général, et le Comité, en particulier, sont-ils préparés à cette évolution ?
Les architectes sont par essence des généralistes. Grâce au travail qu’elle mène en profondeur, la SIA joue un rôle important dans la professionnalisation de nos disciplines et fournit des outils indispensables pour faire face aux défis complexes, tels que le changement climatique. Cependant, le risque existe de voir cette différenciation technique se transformer en hyperspécialisation, au détriment d’une vision plus généraliste.
J’ai beaucoup d’estime pour le haut niveau d’expertise dont témoignent les membres dans leur travail de normalisation, mais je pense qu’il est tout aussi essentiel de garder une vue d’ensemble. C’est même sur ce point que je vois l’une des missions principales de notre métier, celle qui consiste à appréhender des problématiques complexes, à les structurer et à les développer de manière responsable.