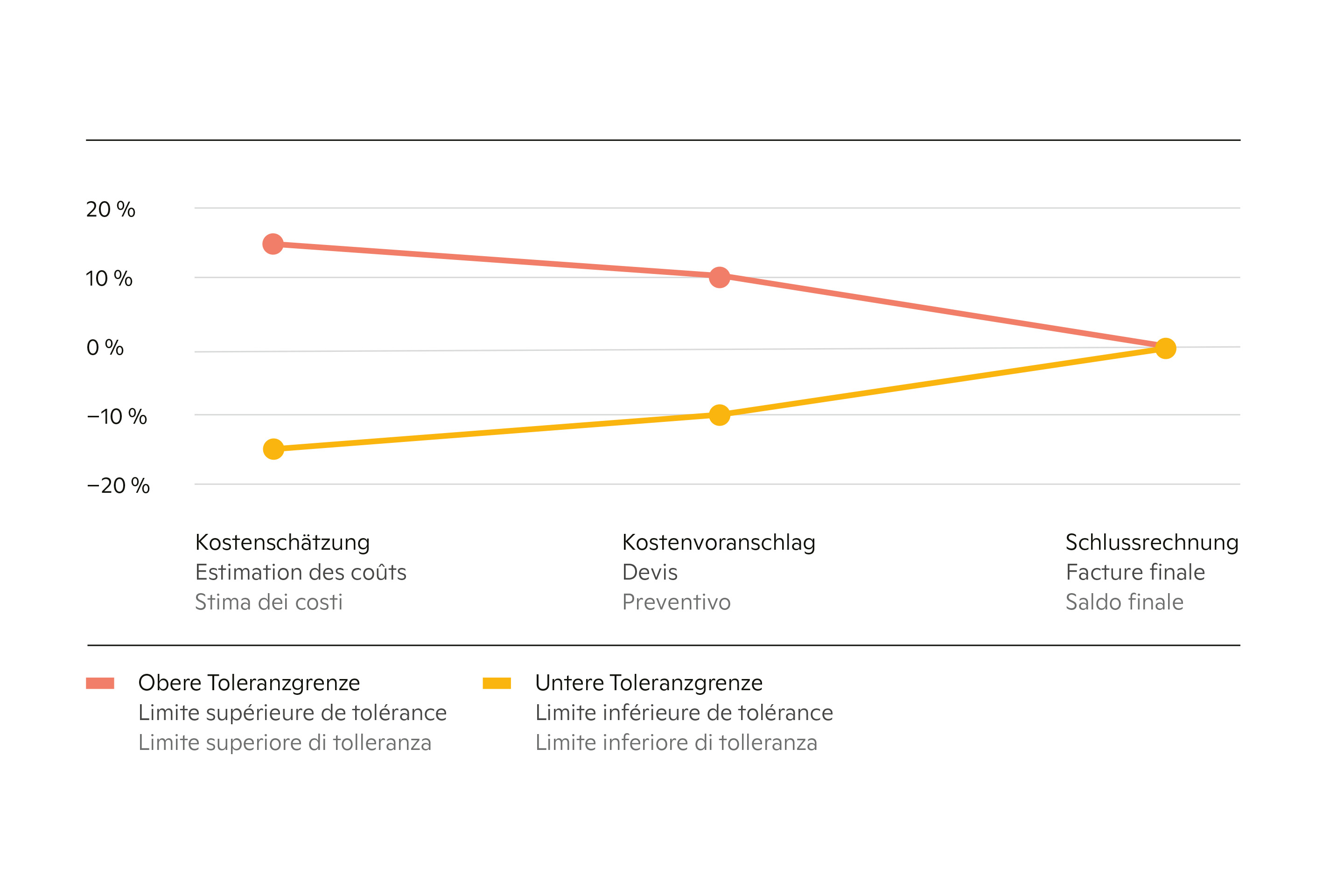« Il faut des processus standardisés et des produits modulables »
Le bois issu de déconstructions reste une ressource sous-employée, dont nous dépendrons à l’avenir. Les conditions déterminant son réemploi ou sa revalorisation font l’objet de recherches à la haute école spécialisée de Berne.
Monsieur Thömen, pourquoi le réemploi ou le recyclage du bois sont-ils importants ?
Dr Heiko Thömen : Je complèterais votre question par: «…alors qu’à la différence des terres rares, des matières synthétiques ou de l’aluminium, le bois repousse.» On doit en effet se demander s’il est fondé d’appliquer les mêmes principes au bois, qui est intrinsèquement lié au cycle naturel fermé du carbone. D’autres raisons doivent donc justifier les efforts pour prolonger également son cycle de vie.
Quelles sont ces raisons?
Vu la multiplication de ses usages, la demande de bois croît : la construction en bois est en plein essor et le matériau s’affirme en remplacement de produits synthétiques, ainsi que comme combustible renouvelable. De plus, avec le changement climatique, la disponibilité des résineux, plus aisément utilisables, va s’amenuiser au profit des feuillus. C’est pourquoi il faut employer efficacement le matériau brut et le réutiliser plusieurs fois. Nous sommes malheureusement prisonniers d’habitudes qui se sont développées pour d’autres matières. Or, le statu quo n’est plus de mise ; le bois mérite une application des principes d’économie circulaire conforme à sa matérialité.
Et qu’en est-il du CO2 rejeté lorsque le bois est brûlé? Ne faudrait-il pas éviter cela le plus longtemps possible?
Le stockage du CO2 demeure temporaire et il faut se garder d’en surestimer l’effet. À long terme, il est climatiquement beaucoup plus important de construire avec des matériaux durables générant peu d’émissions.
Cet article est paru dans le numéro spécial «La ville en bois - Établissements de soins et économie circulaire». Vous trouverez d'autres articles sur la construction en bois dans notre dossier numérique.
Vous avez accompagné des projets pilotes de déconstruction de bâtiments en ciblant le bois usagé. Quelles premières conclusions en tirez-vous?
Les défis portent sur la logistique et les assemblages métalliques tels que vis, clous et agrafes. Nous sommes en train de développer des méthodes pour retirer les assemblages métalliques du bois usagé. Au niveau des coûts, il n’y a pas de sens à préparer des éléments pour les stocker en de multiples dimensions. Il faut des processus standardisés automatisés et des produits modulables.
Comment s’opère le triage – où vaut-il la peine (ou non) de revaloriser ou de réemployer du bois issu de démolitions?
Un plancher laminé, constitué de fibres, ne peut être recyclé pour des raisons techniques. Des châssis de fenêtre en bois massif s’y prêtent en revanche mieux, si ce n’est qu’ils sont souvent encastrés et difficiles à prélever et qu’il ne s’agit que de faibles quantités. À l’inverse, un grenier offre du volume et son accessibilité le prédestine au réemploi.
Vous avez évoqué la logistique. Mais sur un chantier tout doit aller vite et s’il faut y intercaler des étapes pour déconstruire un élément spécifique, les coûts s’en ressentent.
Vous le dites, le temps c’est de l’argent et dans un déroulement de projet normal, aucune phase n’est prévue pour une déconstruction chronophage. Et pour séparer les matériaux, il faut plusieurs bennes, donc de la place, ce qui fait parfois défaut en milieu urbain comme à Berne ou à Zurich.
Que pourrait-il advenir des poutres d’un grenier, par exemple?
On peut envisager le réemploi de telles poutres dans une charpente. Mais cela ne me paraît possible sous leur forme originale que dans des cas rarissimes. Si nous voulons réinsérer dans une nouvelle structure des poutres usagées, qui présentent un volume donné et peut-être même de légères déformations, cela n’est guère compatible avec un haut niveau d’automatisation.
Un grenier est un bâti au moins autoporteur, ce qui implique des clarifications statiques. Du bois de réemploi y est-il adapté?
Une poutre non sollicitée et non exposée à des variations d’humidité conserve ses propriétés. D’éventuelles contraintes antérieures compromettant la capacité porteuse sont toutefois difficiles à déceler. Un autre problème concerne les joints collés, dont la qualité ne peut être attestée que de façon limitée. Nous avons donc besoin d’expertise qualifiée en matière de réemploi de bois usagé à des fins porteuses. La recherche s’active sur ces questions.
Le bois doit-il être testé sur sa teneur en formaldéhyde ou en produits nocifs, tels que des enduits de protection?
Le défi est de déceler les contaminations sur le chantier avant la déconstruction ou lors du triage. Il faut donc poursuivre le développement des méthodes et instruments d’analyse mobiles – par exemple pour les substances de protection. Je n’ai pas connaissance de hautes teneurs en formaldéhyde dans du bois usagé et, le cas échéant, celles-ci apparaîtraient au plus tard lors de la production de dérivés issus de ce bois.
INNOVER POUR BÂTIR L’AVENIR : LE PROJET THINK EARTH
Think Earth est un projet phare d’Innosuisse axé sur la régénération du bâti. Il se concentre sur le bois et l’argile comme matériaux écologiques. Dans le cadre de dix projets partiels associant recherche, industrie et pouvoirs publics, il vise à développer des constructions hybrides, promouvoir l’économie circulaire et défricher de nouvelles voies pour un bâti favorable au climat.
Le projet partiel 5 s’attache à accroître le taux de réemploi des déchets de bois et à en augmenter la valeur. Les points clés incluent l’amélioration des moyens diagnostiques pour un triage plus précis, l’optimisation de la logistique et des chaînes d’approvisionnement, la fermeture des cycles des matériaux et l’élaboration de processus automatisés pour la transformation de déchets de bois en éléments massifs standardisés et en matériaux de construction de haute valeur.
➔ Plus d'informations sur le projet: Think Earth