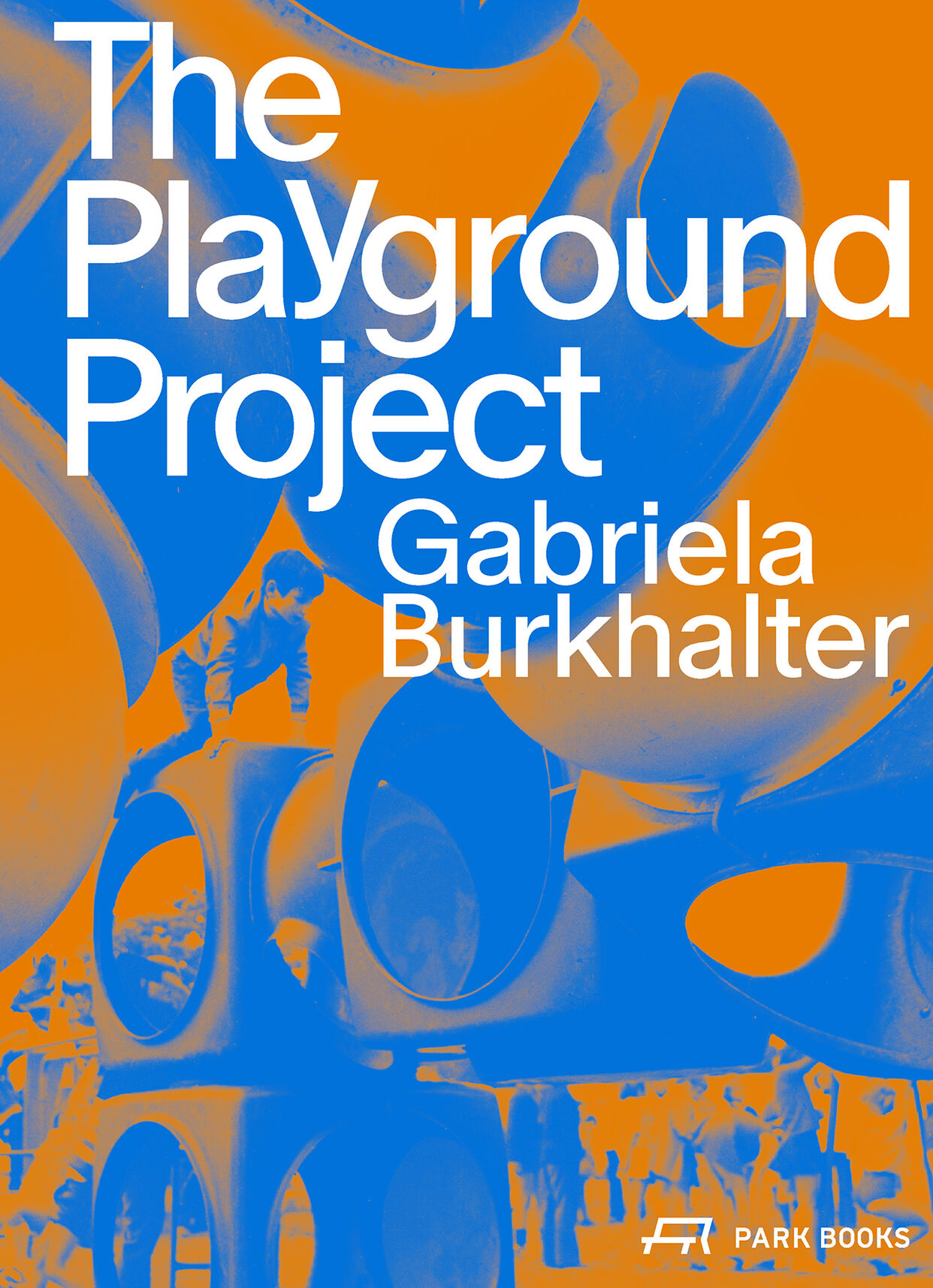The Playground project
Activité ludique en milieu urbain – vagues et ressacs
Gabriela Burkhalter est une urbaniste et politologue suisse. En 2016, elle a été commissaire à la Kunsthalle de Zurich de l’une des recherches les plus exhaustives et précises concernant le développement des places de jeux: l’exposition The Playground project, qui a ensuite fait l’objet d’un livre. Elle y présente l’évolution formelle des aires de jeux de la fin du 19e siècle jusqu’aux années 1980 dans les villes occidentales. Burkhalter s’est notamment intéressée aux exemples qui se distinguaient des modèles stéréotypés dénoncés par l’historienne américaine des aires de jeux Susan Solomon: les «4S», pour slides (toboggan), swings (balançoires), sandboxes (bacs à sable) et seesaws (tape-cul).
Burkhalter identifie au cours des 150 dernières années quatre phases de développement des places de jeux, qui seraient comme des vagues et des ressacs.
L’aménagement des playgrounds émerge d’abord dans les villes en plein développement industriel, à la fin du 19e siècle. Ils sont nés de l’initiative de différents mouvements liés à l’amélioration de la qualité de vie au sein des populations ouvrières paupérisées, afin de proposer aux enfants livrés à eux-mêmes des centres dédiés à la pédagogie et au jeu. Avec cette première vague, on sort les jeunes de la rue pour les faire jouer dans des espaces protégés.
Dans les années 1930, et tout particulièrement en Scandinavie, ressac: on estime que les enfants sont trop enfermés sur les places de jeux et qu’ils devraient jouer davantage avec des matériaux naturels, dans un esprit d’autodétermination. Les terrains d’aventure, espaces d’activités libres où les enfants peuvent imaginer et construire leur propre univers, presque sans l’intervention des adultes, émergent à cette époque entre le Danemark et l’Angleterre. En Suisse, c’est Alfred Ledermann, secrétaire général de la Fondation Pro Juventute, qui introduit le concept – skrammellegeplads en Scandinavie –, sous la forme des Robinsonspielplatz (Jardin Robinson).
Dès la fin des années 1960, nouvelle vague: si depuis le début du 20e siècle les places de jeux ont été entretenues et aménagées par les municipalités ou des organisations semi-publiques, les mouvements de 1968 transforment non seulement la politique et la société, mais également la manière dont l’espace public doit être aménagé. Le dénominateur commun de ces mouvements hétéroclites? La contestation de l’autorité, qui imprégnera le dessin même des places de jeux. Parallèlement aux idées d’autonomisation et de développement personnel, les groupes locaux et les collectifs s’impliquent donc directement dans la conception et la construction des playgrounds.
Pourtant, dès les années 1980, le déclin des idées utopiques, le repli de l’État, les coupes budgétaires et les politiques dérégulatrices entraînent une crise de l’aménagement urbain – et par extension, de l’aménagement des places de jeux. Ressac.
Gabriela Burkhalter, The Playground project, Parkbooks, 2023