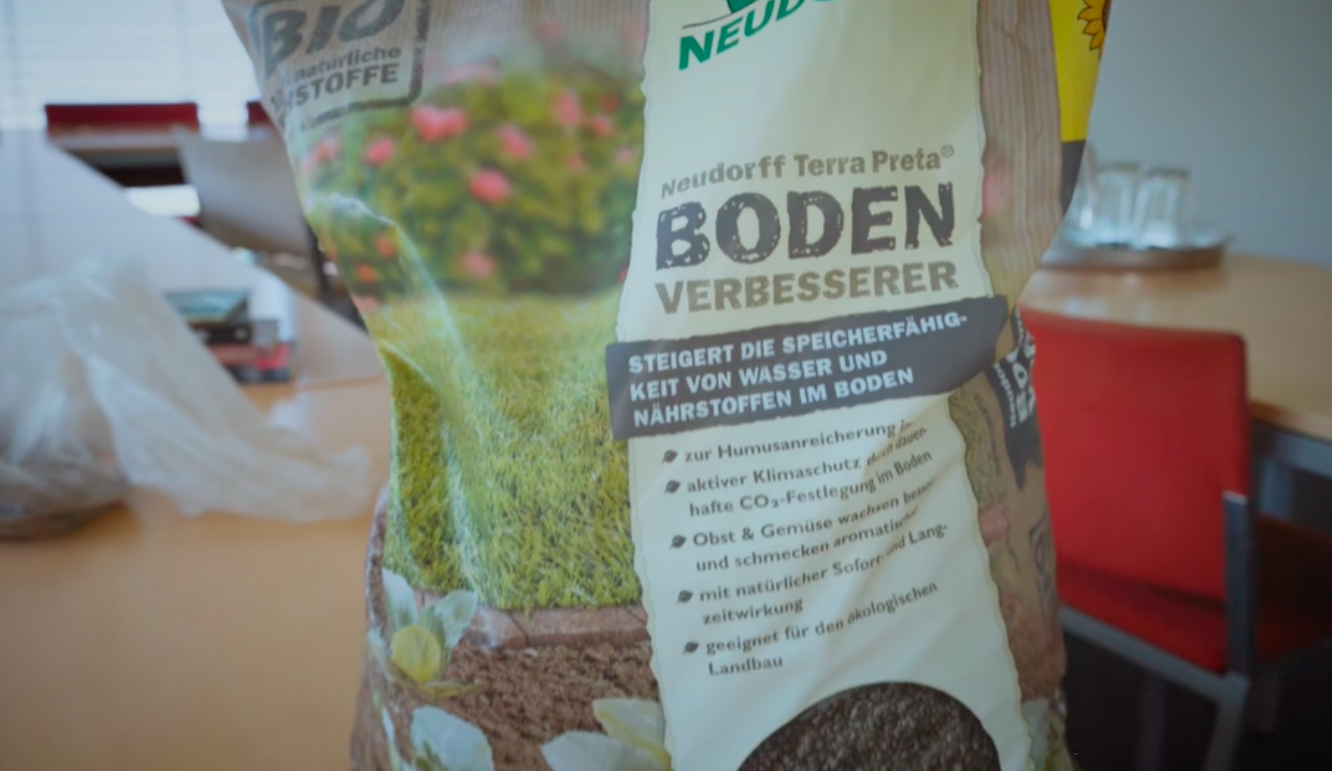Triennale de Lisbonne
ou le dernier colloque des cybernéticiens
Bien plus compacte et cohérente que la Biennale de Venise, la Triennale de Lisbonne, qui vient de s’ouvrir, ne décevra pas celles et ceux qui y chercheront un condensé stimulant de ce que la recherche en urbanisme, en architecture et en ingénierie de l’environnement peut offrir de plus pertinent.
Les commissaires de la Triennale 2025, Ann-Sofi Rönnskog et John Palmesino, enseignants à la AA School et fondateurs de la Territorial Agency, s’inscrivent parfaitement dans une tradition post-marxiste qui contribue à la réputation de la célèbre école, autant qu’elle en fait désormais une cible de prédilection de la nébuleuse trumpiste. Le propos complexe qu’ils déploient en trois volets distincts, Fluxes, Spectres et Lighter, s’avère capable de faire entrer en synergie une cinquantaine de projets autour de la ville, du désastre environnemental et, plus largement, du poids de nos modes de vie, qu’il s’agisse de construction, de déplacements, de production ou de consommation. L’intention n’est pas seulement d'illustrer la catastrophe, mais d'en prendre la mesure pour faire interagir les différents registres de calcul, d’où le titre de cette édition: “How heavy is a city?”
Prendre la mesure de nos actions
Au lieu de juxtaposer des propos et des recherches, Rönnskog et Palmesino optent pour une organisation systémique. Leur triennale se veut une tentative d’organiser des études et des thèses de manière à révéler des champs d’interaction inédits. Comme le sujet d’un grand nombre de ces recherches relève d’une appréhension élargie de la cybernétique, leur triennale prend rapidement la forme d’un système des systèmes, ou d’une cybernétique des cybernétiques.
Nous sommes, de toute façon, dans l'extension des catégories. L'architecture devient ce qui déborde de la discipline au sens strict, tout comme la ville est tout ce qui touche, de près ou de loin, à la vie urbaine: que ce soient les campagnes cultivées mécaniquement pour nourrir les citadins, ou les territoires prétendument naturels, perçus à travers le prisme des habitants des villes.
Dans un monde globalisé où l'extérieur n'existe plus, où le vivant dans son ensemble prend part à l'Anthropocène, la question qui se pose est celle des boucles rétroactives et de leur gestion. Sauf qu'en 2025, à l'aube d'une nouvelle ère de l'information, il ne s'agit plus d'établir une cybernétique de la ville ni de son rapport à la campagne, mais plutôt de constater la multitude de boucles rétroactives générées par nos actions, et qui nous affectent en retour. En ce sens, la Triennale invite à se déplacer aux frontières du pensable, aux limites de ce qui est calculable, et de ce qui entre ou non dans notre champ perceptif et décisionnel.
Cela peut aller de la compréhension des voies rapides en tant que pollinisateurs – les pneus des véhicules captant et déplaçant du pollen (Collectif Dorsa) –, à la forêt vierge perçue comme une construction idéologique appelant son exploitation (Paulo Tavares), et jusqu'à l'échelle planétaire de l'extraction, avec les mines à ciel ouvert de sables bitumineux de l'Alberta, photographiées par Iwan Baan. Là, le slogan «Drill, baby, drill» atteint des proportions inimaginables, visibles depuis l'espace.
L’IA peut-elle offrir une critique post-marxiste?
Palmesino et Rönnskog ont fait le choix d'un traitement égalitaire des études exposées, ramenant tout au format vidéo, à quelques exceptions près, comme les gigantesques panneaux noirs et blancs des spécialistes de l’IA Kate Crawford et Vladan Joler, qui répertorient l'évolution des instruments de mesure. Leur classement pourrait servir d’index à la Triennale dans son ensemble, tant la question de la mesure et de ses significations est centrale. Quimesure et pourquoi?
Humboldt, qui s’acharnait à classifier la forêt tropicale, comprenait-il à quel point son entreprise exploratrice faisait le lit de l’exploitation coloniale? Et de nos jours, quel est le sens d’une archéologie des cybernétiques au seuil d’une nouvelle révolution médiatique et cognitive qui annonce déjà l’invisibilisation de tous ces systèmes dans les méandres algorithmiques?
L’IA est-elle seulement capable de mesurer la position paradoxale qui est la sienne, d’annuler par sa seule demande énergétique tous les efforts entrepris ces 50 dernières années pour réduire la consommation énergétique mondiale?
Et puisque l’IA ne veut pas faire son autocritique, Kate Crawford s’en charge avec un essai d’une rare virulence, où la boulimie de données ingurgitées par ses machines devient, par la force des choses, autophagie numérique des systèmes qui s’alimentent en boucle fermée, pour terminer en scatophagie des émetteurs et des usagers. Rarement avertissement aura été aussi précis et radical. Est-ce à dire que la Triennale va sonner l’alerte? Rien n’est moins sûr, tellement les boucles rétroactives qui captent l’attention des citoyens du 21e siècle préfèrent faire tourner de la fange que ce type de contenu exigeant. Pour chaque lecteur unique de Crawford, combien de millions d’usagers vont se laisser dorloter par des memes absurdes comme Bombardino Crocodilo? L’humain n’aura bientôt plus de place dans les boucles rétroactives qui génèrent des contenus, qu’ils soient informatifs, divertissants ou pédagogiques. Il est déjà éjecté des dispositifs de production. On ne lui demande que d'ingurgiter.
Cette Triennale exigeante et pointue, qui ressemble à un cabinet de curiosité éco-scientifique, pourrait être perçue comme un ultime baroud d’honneur de l’intelligence humaine face à la déferlante des IA. Un ultime colloque de cybernéticiens, avant l'extinction définitive de la cybernétique en tant que pratique poétique humaine.
Christophe Catsaros est critique d'architecture indépendant et ancien rédacteur en chef de la revue Tracés.
Un prix pour Yasmeen Lari
Tout n’est pas perdu à Lisbonne. Malgré les constats très pessimistes qui ont résonné lors de l’inauguration de la Triennale, le choix d’attribuer le prix d’excellence 2025 à l’architecte pakistanaise Yasmeen Lari constitue une lueur d’espoir. Sa carrière, qui s'étend sur plus de six décennies, est marquée par un choix déontologique radical : zéro carbone, zéro déchet, zéro donateur et zéro pauvreté. Ce choix prend une importance particulière quand on considère l’ampleur de son œuvre. Elle a contribué à la réalisation de plus d’un million de maisons.
Seventh Lisbon Architecture Triennale
How heavy is a City?
2.10-08.12.2025
Headquarters: Palácio Sinel de Cordes
Informations