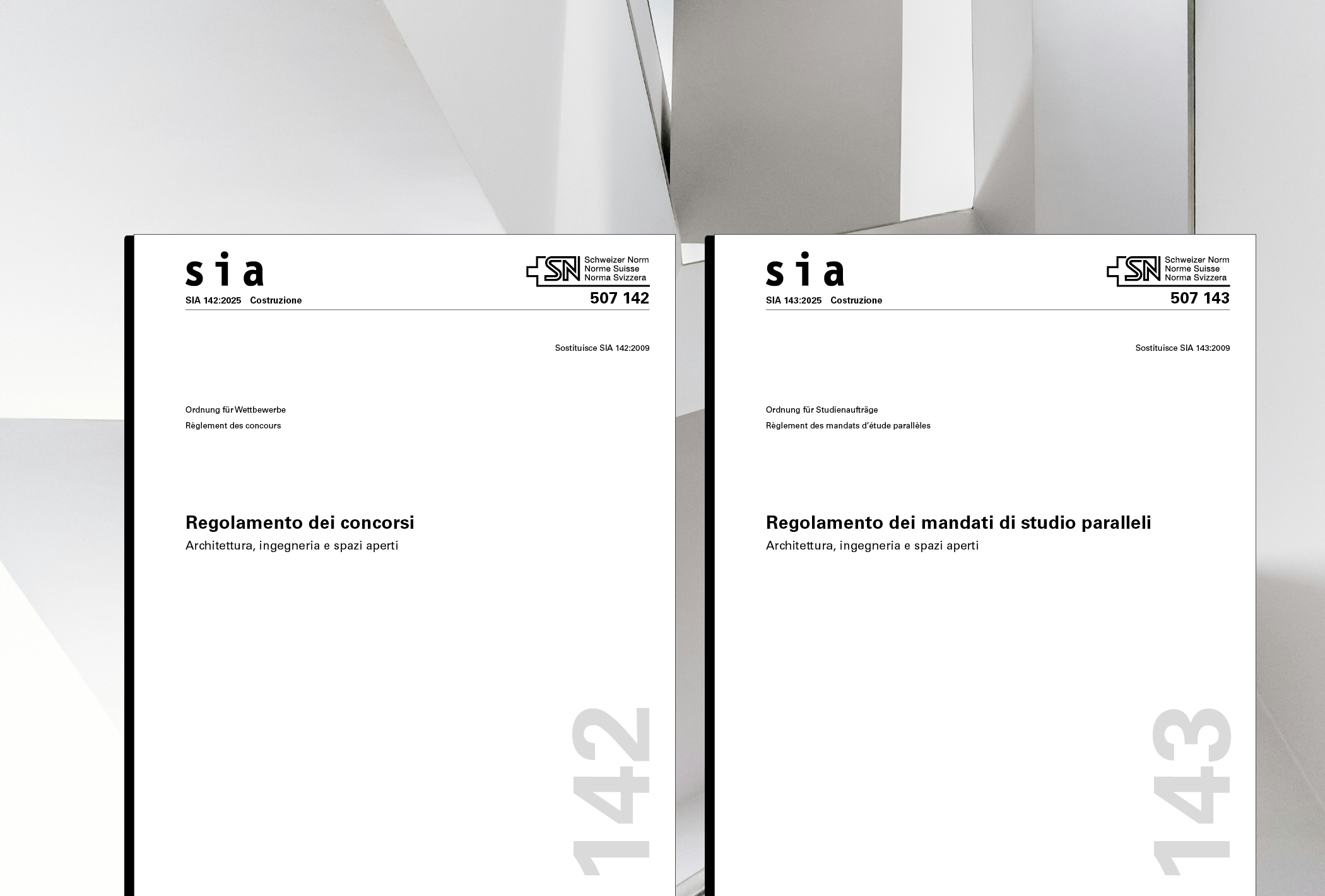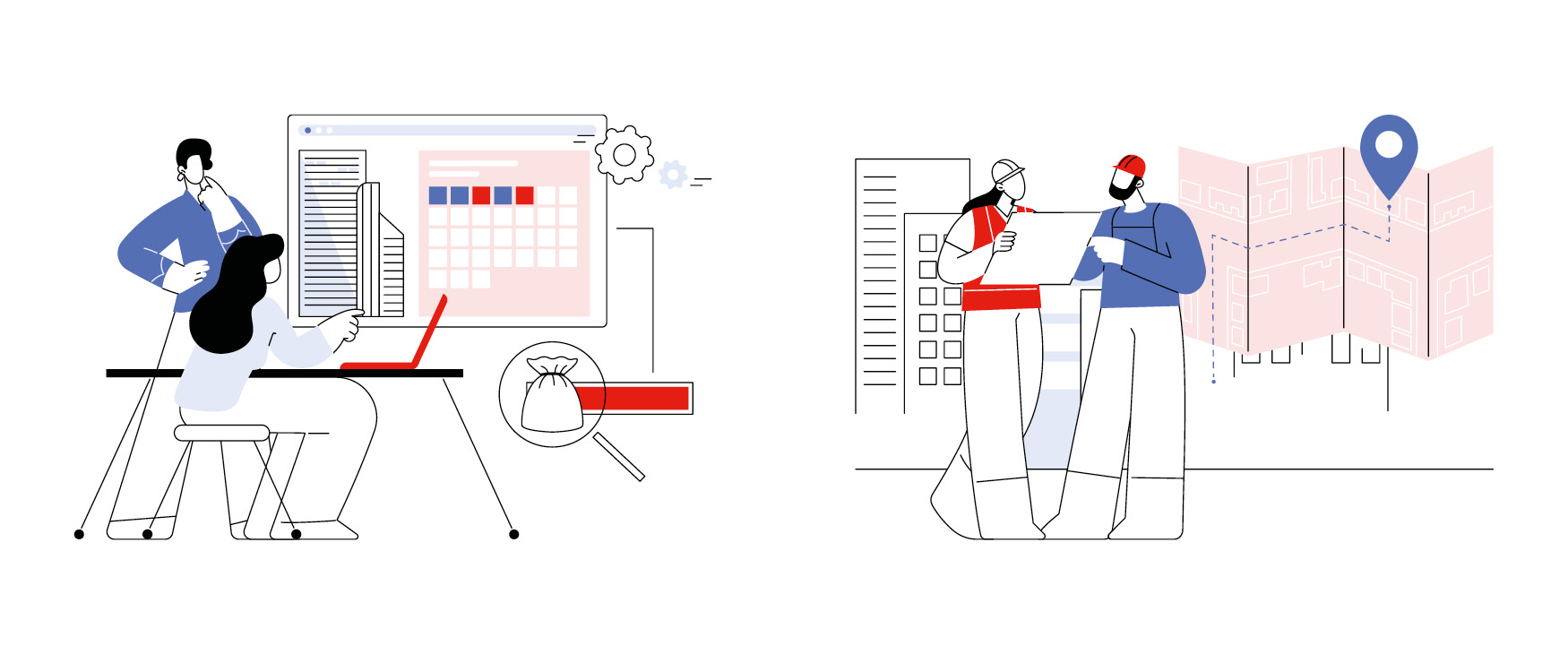Une géante pleine de tonus
SIA: 175 d'existence
Plus âgée que l’Etat fédéral, la SIA arbore une complexité semblable. Or comme l’énonçait Ben Vautier pour pointer la diversité helvétique dans le cadre de l’exposition universelle de Séville en 1992 : «la Suisse n’existe pas». Le slogan irrite toujours et peut s’appliquer à la SIA par analogie : elle n’est pas une, mais multiple. En fonction du point de vue adopté, ce qui en fait la substance s’exprimera différemment. Structure matricielle aux multiples enchevêtrements ancrés dans les régions, elle présente un organigramme dont le secrétariat général de Zurich maintient les articulations.
Il est d’autant plus étonnant qu’une telle organisation ait pu être résumée en une simple phrase sur son site web : «Bâtie sur un modèle fédéraliste, elle se compose de la Société centrale, la SIA Suisse, des sections actives sur le plan régional, ainsi que de quatre groupes professionnels et des sociétés spécialisées qui cultivent les échanges dans les différents domaines d’expertise». Tandis que les 18 sections assurent la vie de la Société et entretiennent les contacts avec les pouvoirs locaux, les quatre groupes professionnels se déploient à l’échelon national et incarnent l’interdisciplinarité qui la caractérise.
Comme membre, on adhère à la fois à une section et au groupe professionnel approprié: Architecture, Génie civil, Technique / Industrie ou Sol / Air / Eau. Cette réunion de différentes disciplines est une caractéristique aussi primordiale que potentiellement conflictuelle de la Société, qui a d’ailleurs failli briser son unité dans les années 1990. Elle émane du vœu des pères fondateurs de rassembler les architectes et les ingénieurs de toutes les spécialités dans une association nationale, dont l’unique but premier était l’avancement des connaissances en architecture et sciences de l’ingénieur, grâce à la diffusion d’expériences acquises et à l’examen de questions essentielles pour ces domaines (Neaf, 1937: p.145). Lors de la fondation de la Société à Aarau en 1837, les échanges s’avèrent en effet beaucoup plus difficiles qu’aujourd’hui: il n’y a pas encore d’EPF, les revues spécialisées sont pratiquement inexistantes et l’absence de chemins de fer oblige à endurer le cahot des diligences sur des routes rudimentaires.
Interdisciplinarité et coopération
Si cette union entre ingénieurs et architectes a pu perpétuer la tradition du maître d’œuvre comme « faiseur » en opposition à la figure de l’architecte orienté beaux-arts , l’entrée en force dans l’ère industrielle s’accompagne d’une redistribution des rôles. Les années 1860 sont ainsi marquées par le dynamisme et l’influence prépondérante des ingénieurs, portés par la fièvre du chemin de fer qui gagne la Suisse avec quelque retard. Cela étant, l’esprit d’interdisciplinarité et de partenariat qui fonde la recherche d’équilibre entre les intérêts représentés au sein de la SIA perdure jusqu’à aujourd’hui. Il ne simplifie certes pas le profilage de l’association, ni sa gouvernance, mais reflète bien la complexité inhérente à une branche telle que la construction, appelée à composer entre de multiples influences et intérêts. A l’occasion du centième anniversaire de la Société, Paul G. Vischer, le président d’alors, réaffirme l’importance de la démarche collaborative, en rappelant que le nombre d’installations techniques dans toute construction exige la coopération entre tous les intervenants et que la la SIA doit absolument veiller au maintien de l’intercompréhension entre techniciens et bâtisseurs (Vischer, 1937: p.204). Les développements qui interviennent après la Seconde Guerre mondiale entraînent toutefois une spécialisation toujours plus poussée : de nouveaux modèles de collaboration entre concepteurs, entrepreneurs et maîtres de l’ouvrage avec l’apparition de l’entrepreneur général ébranlent les profils professionnels classiques et modifient durablement la vision que les différents acteurs se font de leurs rôles respectifs. Le contrôle de l’exécution, comme tâche attitrée de l’architecte pour assurer la qualité d’un ouvrage, menace de lui échapper une tendance qui s’affirme plus que jamais aujourd’hui. Et la révision des règlements sur les honoraires, qui introduit notamment l’adjudication de parts de prestations et un calcul des honoraires détaché du coût de l’ouvrage, se traduit par d’importantes tensions au sein de la SIA au milieu de la décennie 1980. Une sécession des architectes n’est finalement évitée qu’avec la mise en place des groupes professionnels déjà évoqués et leur ancrage dans la révision statutaire intervenue en l’an 2000.
Règlements de branche et politique professionnelle
Dès les années 1870, la défense des intérêts corporatifs face à l’extérieur et la politique professionnelle prennent une importance sans cesse accrue. Outre le renforcement des échanges entre pairs, avec l’établissement des «relations entre les personnes qui suivent la vocation, d’ingénieur ou d’architecte», les statuts de 1877 assignent à la Société le nouveau but suivant: «
de faire progresser l’étude de l’art et de la pratique des constructions, de contribuer à accroître et à développer la considération et l’influence qui se rattachent aux professions techniques et de servir à celles-ci d’organe et de représentant en Suisse auprès des autorités et du public.» (Bulletin de la Société vaudoise des ingénieurs et des architectes, 1876: p.26). En contrepartie, les membres doivent se soumettre à certains devoirs et s’engager à respecter des standards de qualité élevés et une déontologie irréprochable. Des impératifs qui sont à la base du Code d’honneur finalement introduit en 1937, après trente ans de travaux préparatoires.
Les motifs qui obligent à rappeler régulièrement au respect des règles sont multiples. L’absence de protection des titres est ainsi invoquée de manière récurrente dans la mesure où elle permet à des techniciens, même «professionnellement et moralement non qualifiés» (Naef, 1937: p. 162), de pratiquer. Or la SIA entend tenir de tels collègues à distance et l’un des moyens mis en vigueur jusqu’à aujourd’hui est de restreindre l’affiliation aux confrères de formation supérieure, soit aux ingénieurs et architectes des filières universitaires. Avec l’introduction des registres REG en 1966, une voie d’admission pour les professionnels qualifiés issus d’autres filières est toutefois créée.
Avec le poids croissant accordé à l’économie et face au durcissement de la concurrence, les possibles violations du Code d’honneur se font aussi plus nombreuses. Sous peine d’éventuelles sanctions, la SIA exige donc de ses membres qu’ils fassent preuve d’autodiscipline en observant une déontologie exemplaire et elle a très tôt instauré des normes et des règlements qui définissent les conditions de l’exercice professionnel.
Normalisation et système de milice
Les premiers tarifs d’honoraires pour les travaux d’architecture paraissent en 1877, en même temps que les principes pour l’organisation de concours d’architecture(Hässig, 1937: p. 179), deux règlements qui seront constamment réadaptés et mis à jour et qui conservent une importance centrale aujourd’hui. 1883 marque la parution d’un premier standard de nature technique pour l’adoption d’une brique normalisée (Naef, 1937: p. 158) et les normes techniques de la SIA sont aujourd’hui des outils professionnels incontournables en Suisse. Elles constituent des garanties de qualité, balisent l’étude et la réalisation d’ouvrages et fixent des valeurs-limites qui accroissent notamment la sécurité et l’aptitude au service des ouvrages, d’où leur utilité majeure pour les concepteurs comme pour les maîtres de l’ouvrage. Avec les cotisations de ses membres, la diffusion de ses normes, règlements, recommandations et directives représente d’ailleurs la principale source de revenus de la Société ; en cas de litige, les tribunaux se référent à ces textes lorsqu’il s’agit d’établir les règles actuellement admises dans l’art de bâtir.
La collection des normes est sans doute l’œuvre principale de la SIA et celle qui a le plus contribué à sa notoriété jusqu’à aujourd’hui? (Portmann, 1987: p. 55). Les normes et règlements SIA continuent à être élaborés par de nombreuses commissions, sur une base principalement bénévole, avec le soutien du secrétariat général qui en assure le suivi. Contrairement à ce qui prévaut à l’étranger, les standards applicables à la construction en Suisse sont ainsi majoritairement établis par la SIA, soit par un organisme privé. La Société s’est elle-même donné cette mission et les pouvoirs publics profitent à tous les échelons de ce précédent historique. L’esprit de milice qui anime les commissions ainsi que leur composition paritaire ont d’une part l’avantage de réunir d’emblée les différentes disciplines et groupes d’intérêts concernés par les prescriptions à définir. D’autre part, des normes sont plus facilement adaptables que des dispositions légales, ce qui en accroît la flexibilité en favorisant l’innovation et un suivi permanent. Cela étant, le principe du bénévolat touche aujourd’hui à ses limites, les problématiques se complexifient, les développements européens doivent être pris en compte et le volume de travail à fournir augmente. De plus, les procédures établies au sein de la Société prennent du temps et la prise de décision s’avère souvent laborieuse.
Une optimalisation des structures est toutefois en cours. Tandis que la direction de la SIA est appelée à renforcer encore son rôle stratégique, le secrétariat général conduit les affaires courantes sous la houlette du secrétaire ou de la secrétaire générale, une tâche qui ne cesse de s’étendre et de se complexifier. Outre la gestion des normes et les autres prestations assumées par la SIA, les priorités en matière d’énergie, de formation, d’aménagement territorial, de passation des marchés et de défense de la culture bâtie figurent au premier plan. Ce dernier enjeu est d’autant plus actuel que dans son message culturel pour les années à venir, l’exécutif fédéral limite la sollicitude publique au patrimoine historique, mais continue à largement ignorer la création architecturale et le génie civil contemporains.
La SIA renforce donc son engagement sur ce plan. Son action va de l’organisation de la table ronde nationale sur la culture bâtie, à la remise de la distinction «Umsicht Regards Sguardi» qui met en valeur de nouveaux ouvrages illustrant des développements pionniers, en passant par la « 15n de l’architecture et de l’ingénierie contemporaines », durant laquelle les professionnels SIA ouvrent annuellement les portes de leurs réalisations au grand public. Aujourd’hui forte de 15 000 membres, la SIA incarne l’association suisse de référence dans les domaines de la construction, des installations techniques et de l’environnement. A 175 ans, c’est une géante pleine de tonus qui pérennise son engagement au service des professionnels SIA et de la «Suisse bâtie».