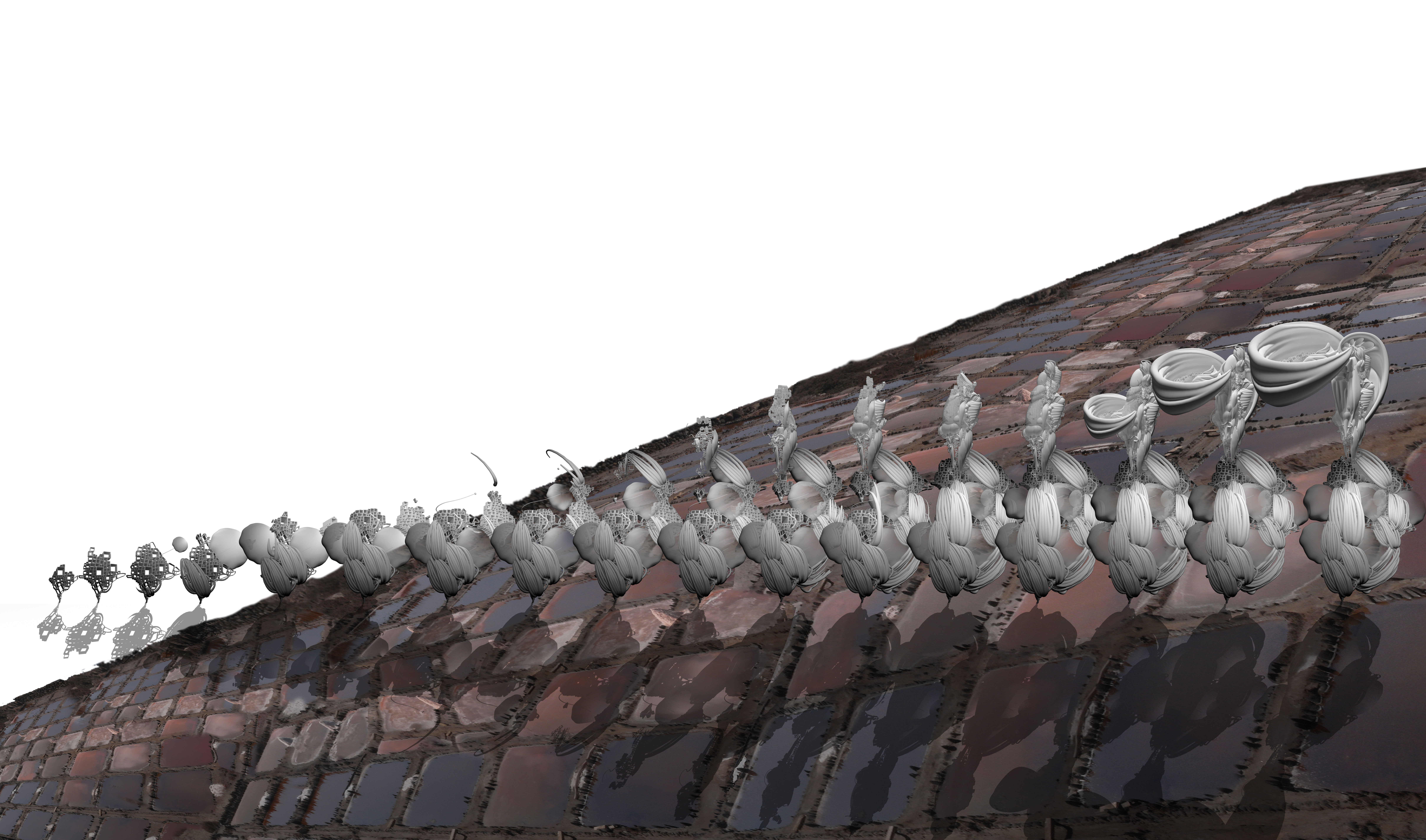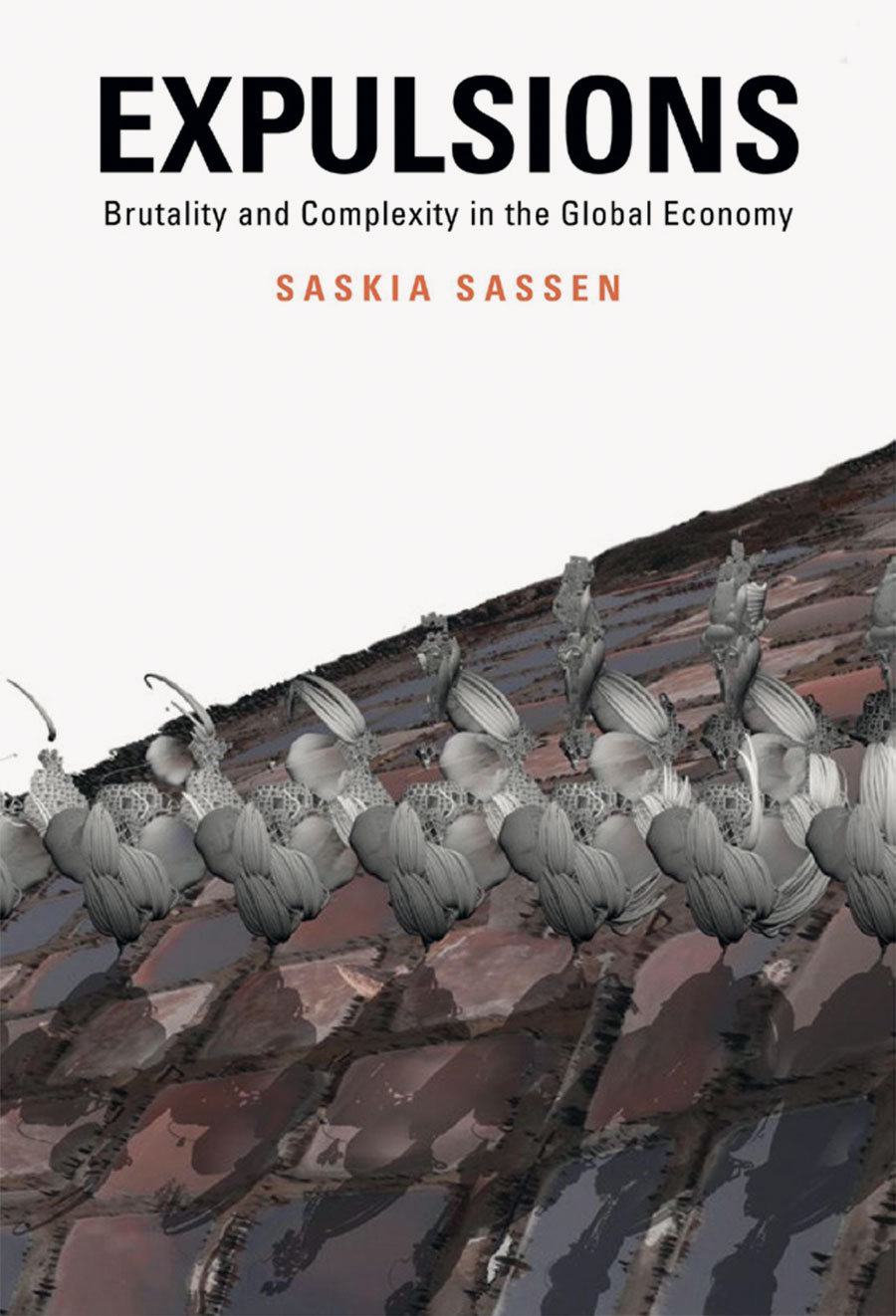La sociologue Saskia Sassen dresse un tableau alarmant du traitement qu’infligent aux sols nos sociétés
Les capacités de la biosphère à renouveler la terre, l’eau et l’air sont remarquables, mais elles se fondent sur des temporalités et des cycles de vie spécifiques. Au cours de ces dernières décennies, ces capacités ont été prises de vitesse par nos innovations techniques, chimiques et organisationnelles. Aujourd’hui, de vastes zones de terre et d’eau sont mortes terres anéanties par l’utilisation abusive de produits chimiques, eaux stériles en raison d’un déficit d’oxygène dû à toutes sortes de pollution.
Dans cet essai, j’examinerai la question des terres soumises à des conditions extrêmes. Cette vision, partiale, repose sur le postulat que ces dernières rendent clairement visible ce qu’il est plus difficile à appréhender dans des cas moins exceptionnels. Pour la plupart, les régions de notre planète sont encore vivantes, mais il en meurt de plus en plus.
La perte des terres
De même qu’il existe une grande variété de terres, il existe de multiples causes à la dégradation des sols. L’érosion, la désertification, la surexploitation et la monoculture dans les plantations sont les principales causes de la destruction des terres agricoles. Le changement climatique est à l’origine de vagues de chaleur d’une intensité rarement vue, qui affectent des zones rurales du monde entier, dont des terres de grande qualité qui se sont très longtemps illustrées par un fort rendement. Ces vagues de chaleur et leurs répercussions sont probablement la principale source de dégradation du sol dans les régions agricoles. L’exploitation minière et les déchets industriels dégradent aussi la terre, mais de manière très différente.
Les médias nous livrent par ci, par là des informations qui laissent penser que la fragilité croissante de la terre n’a pas été largement comprise ni admise. Ainsi, d’après certains sondages, peu de citoyens américains savent que, selon des paramètres scientifiquement établis, plus d’un tiers des terres du pays, dont les plaines si fertiles et tant aimées du Midwest, sont menacées. De même, peu de gens savent que sur une grande partie de la côte Ouest, on a relevé au moins 400 zones mortes dans les eaux côtières, qui détériorent l’état général des terres du littoral. C’est nous qui avons créé cette fragilité et ces espaces stériles.
Le développement des plantations et des mines a fait disparaître la faune et la flore dans de vastes régions du globe, les vouant à n’être plus rien d’autre que des sites d’extraction. Or ce processus de destruction s’aggrave. Aujourd’hui, plus de 20 pays ont acquis de grandes étendues de terre hors de leur territoire afin de cultiver les produits dont ils ont besoin pour nourrir leur population. Certaines nations, en particulier le Japon et l’Arabie Saoudite, le font depuis plusieurs décennies, mais ces dix dernières années, le nombre de pays et d’entreprises à acquérir des terres à l’étranger a augmenté de manière exponentielle. Cette demande mondiale a pour effet de «repositionner» la terre sur divers circuits mondiaux ceux des Etats, des entreprises, mais aussi et surtout de la finance. Certains organismes financiers ont également investi dans des terres, non pour les cultiver, mais pour en faire une marchandise et spéculer sur sa valeur.
Globalement, la dégradation du sol se mesure à l’aune d’une perte de la fonction et de la productivité de l’écosystème, une perte dont la terre ne peut spontanément se remettre. Les rares études à avoir tenté de décrire ce processus global estiment qu’environ 40% de la totalité des terres agricoles sont sérieusement dégradés. Les régions les plus touchées sont l’Amérique centrale, où 75% des terres agricoles sont infertiles; l’Afrique, où un cinquième du sol est dégradé; et l’Asie, où 11% des terres sont devenues impropres à l’agriculture.
Aujourd’hui, la température moyenne de la planète a augmenté de 0,8° C par rapport aux niveaux préindustriels du 18e siècle. Un rapport récent sur l’état des terres de la planète, publié par la Banque mondiale, étudie les résultats de plusieurs scientifiques qui énoncent que «si la planète se réchauffe de 2°C un réchauffement qui pourrait être atteint en 20 à 30 années des pénuries généralisées de produits alimentaires, des vagues de chaleur sans précédent et des cyclones plus intenses se produiront. Ce réchauffement de 2° C pourrait se produire en l’espace d’une seule génération».
Ces 50 dernières années, le nombre de régions affectées par la sécheresse a augmenté plus vite que ce que prévoyaient les modèles climatiques. Par exemple, la sécheresse qui s’est abattue sur les Etats-Unis en 2012 a affecté environ 80% des terres agricoles, ce qui en fait la pire sécheresse depuis les années 1950. En Afrique subsaharienne, même avec un «réchauffement inférieur à 2°C d’ici 2050, les récoltes totales pourraient diminuer de 10%. Si le réchauffement est plus élevé, certaines études montrent que les récoltes totales pourraient baisser de 15 à 20% dans toutes les régions» de l’Afrique subsaharienne. Selon ces estimations, un réchauffement de 3°C réduirait la superficie des savanes, passant d’«un quart de la superficie totale des terres à l’heure actuelle à un septième».
Il existe quelques études détaillées sur l’évolution de la dégradation des terres dans le monde depuis la fin des années 1980 et le début des années 1990. Dans l’ensemble, les chercheurs estiment (avec des ajustements différents selon des variables particulières) que 24% de la superficie totale de la terre a subi des dégradations entre 1981 et 20031. Outre ces données générales, ces résultats ont été vérifiés empiriquement dans des régions très différentes dans le nord de la Chine, au Kenya et au Bangladesh.
Ces dernières années, les vagues de chaleur sont devenues la cause principale de la dégradation des terres agricoles, avec les conséquences que l’on sait sur l’approvisionnement alimentaire mondial, en particulier pour les populations pauvres. D’après un rapport de 2013 portant sur plusieurs cas de vagues de chaleur dans différentes parties du monde, la Banque mondiale reconnaît que les cas exceptionnels de vagues de chaleur survenus ces dix dernières années ont des impacts sociétaux majeurs. «Ces événements, extrêmement inhabituels, se sont traduits par une augmentation des températures saisonnières correspondant à un écart-type de plus de 3-sigma par rapport à la température moyenne locale. Sans le réchauffement climatique, ces événements notés 3-sigma ne devraient survenir qu’une seule fois toutes les quelques centaines d’années.»
Les vagues de chaleur entraînent toutes sortes de problèmes. La diminution des précipitations, par exemple, est une source de préoccupation majeure dans certaines régions. Des cas extrêmes touchent l’Afrique australe, où les précipitations annuelles «devraient être réduites dans une proportion atteignant jusqu’à 30% dans le scénario d’un réchauffement de 4°C et certaines régions du sud et de l’ouest de l’Afrique pourraient subir une baisse des taux de réalimentation des nappes aquifères de 50 à 70%». Partout dans le monde, un réchauffement de 1,2° C à 1,9°C à l’horizon 2050 augmenterait la proportion de la population sous-alimentée de 25 à 90% par rapport à la situation actuelle. En Asie du Sud, pareille augmentation nécessiterait de doubler les importations de denrées alimentaires pour répondre à la demande de calories par habitant. «Une baisse de la quantité d’aliments disponibles peut entraîner d’importants problèmes de santé chez les populations touchées, notamment des retards de croissance chez les enfants dont la fréquence devrait augmenter de 35 % d’ici 2050 comparativement à un scénario sans changement climatique.»
Les faits concernant la hausse des températures et leurs causes ont été clairement établis. Le quatrième rapport du groupe d’experts intergouvernemental sur les changements climatiques (IPCC) a reconnu que l’élévation de la température moyenne du globe et le réchauffement du système climatique étaient «sans équivoque». Par ailleurs, «l’essentiel de la hausse de la température moyenne du globe observée depuis le milieu du 20e siècle est très probablement attribuable à l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre anthropiques». Plusieurs études récentes corroborent cette conclusion. Le réchauffement moyen de la planète se situe aujourd’hui à environ 0,8°C au-dessus des niveaux de l’époque préindustrielle. Hansen, Sato et Ruedy (2012) notent également que sans l’activité humaine de ces 50 dernières années, «la somme des forces solaires et volcaniques aurait entraîné un refroidissement, et non un réchauffement».
Les fortes chaleurs estivales sont en grande partie le résultat du réchauffement climatique. Foster et Rahmstorf (2011), entre autres, montrent que si l’on élimine les facteurs connus pouvant avoir une influence sur les variations de température (activité solaire, aérosols volcaniques, El Niño et autres), ces facteurs naturels ne peuvent expliquer le réchauffement. Ce dernier est donc en grande partie le résultat de facteurs anthropiques. Dans les années 1960, les vagues de chaleurs estivales exceptionnelles (qui se différencient de la moyenne climatique de 3 écarts-types) étaient quasiment absentes, affectant moins de 1 % de la surface du globe. La zone affectée a augmenté de 4 à 5% vers 2006-2008, et en 2009-2011 ces pics ont touché 6 à 13% de la surface terrestre. Aujourd’hui, ces épisodes de chaleur extrême affectent environ 10% de la surface terrestre.
Un espace de dévastation pluri-localisé
Les zones de terre morte et dévastée sont comparables à des trous dans le tissu de la biosphère. Dans le livre dont je me suis inspirée pour écrire cet essai, je parle de ces trous comme de zones marquées par l’«expulsion» d’éléments biosphériques hors de leur espace vital. Je considère aussi ces phénomènes en surface comme l’expression de courants souterrains plus profonds qui parcourent le monde entier, et cela indépendamment de l’organisation politico-économique locale ou du mode de destruction de l’environnement.
Ce qui est en train de se produire s’explique par un ensemble de problématiques qui sont spécifiques à chacune des zones touchées. Mais si l’on adopte un point de vue plus conceptuel, ces différences apparaissent comme une sorte de condition générique, caractérisée par un ensemble de terres et d’eaux mortes qui se déploie dans le tissu de la biosphère.
Cet espace de dévastation plurilocalisé nous raconte une histoire celle de la destruction biosphérique dont la portée dépasse de beaucoup le récit particulier et spécifique d’une destruction par les Etats et les secteurs privés. Dans Expulsions, j’analyse des dizaines de cas à plusieurs endroits du globe qui, ensemble, constituent un espace de destruction qui outrepasse les divisions bien connues de notre système géopolitique. La plupart des discussions sur l’environnement mettent trop souvent l’accent sur ces différenciations familières, ainsi que sur la dénonciation des pratiques et des politiques spécifiques aux différents Etats (la pollution liée aux activités minières en Chine, l’industrie chimique en Russie, les mines à ciel ouvert aux Etats-Unis, etc.).
Mais en réalité, du point de vue de la terre, c’est la capacité à détruire l’environnement qui importe. Vu sous cet angle, tous ces cas sont génériques ils sont tous négatifs, indépendamment de la politique ou du vote à l’ONU des pays concernés. J’examine des cas issus de pays ayant des formes d’organisation politique et économique différentes pour indiquer que, si la destruction de l’environnement peut prendre des formes spécifiques selon les Etats certaines étant sans doute pires que d’autres ce sont en définitive leur capacité de destruction qui importe. Une mine qui pollue en Russie aura beau être différente d’une mine qui pollue aux Etats-Unis, il n’en reste pas moins que dans les deux cas, la pollution qu’elles engendrent dépasse le seuil des conditions de viabilité du sol.
C’est en ce sens que j’en appelle à un retour à la terre, afin de dépasser les divisions exacerbées par le système interétatique et ses traités internationaux.
Saskia Sassen est professeure de sociologie, titulaire de la chaire Robert S. Lynd, et co-présidente du Committee on Global Thought à l’université de Columbia. Auteure de plusieurs ouvrages, elle a été l’invitée d’honneur de différentes conférences, a été récompensée par plusieurs prix et a reçu de multiples distinctions et doctorats honoris causa. Son dernier ouvrage s’intitule Expulsions : When complexity produces elementary brutalities, Harvard University Press, 2014.
Note
Cet essai s’inspire du dernier ouvrage de l’auteure, Expulsions : Brutality and Complexity in the Global Economy, Cambridge, Mass : Harvard University Press, 2014, en particulier le chapitre 4 « Dead Land Dead Water » et le chapitre 2 « The New Global Market for Land ».
Références
Bai, Z. G., D. L. Dent, L. Olsson et M. E. Schaepman. 2008. « Proxy Global Assessment of Land Degradation », Soil Use and Management 24, n° 3 (juillet 24) : 223234.
Foster, G. et S. Rahmstorf. 2011. « Global Temperature Evolution 19792010 », Environmental Research Letters 6, n° 4.
Hansen, J., M. Sato et R. Ruedy. 2012. « Perception of Climate Change », Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States 109 : 1472614727.
NOAA. 2012a. « State of the Climate : Global Hazards for July 2012 », National Climatic Data Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, Washington, DC. www.ncdc.noaa.gov/sotc /national/2012/7 (publié en ligne en août 2012).
NOAA. 2012b. « Wildfires-August 2012 », www.ncdc.noaa.gov/sotc /fire/2012/8. Consulté le 4 janvier 2014.
Sassen, Saskia 2014. Expulsions : Brutality and Complexity in the Global Economy, Cambridge, Mass : Harvard University Press.
Banque mondiale. 2013. Baissons la chaleur : Phénomènes climatiques extrêmes, impacts régionaux et plaidoyer en faveur de l’adaptation, Washington, DC : Banque mondiale.