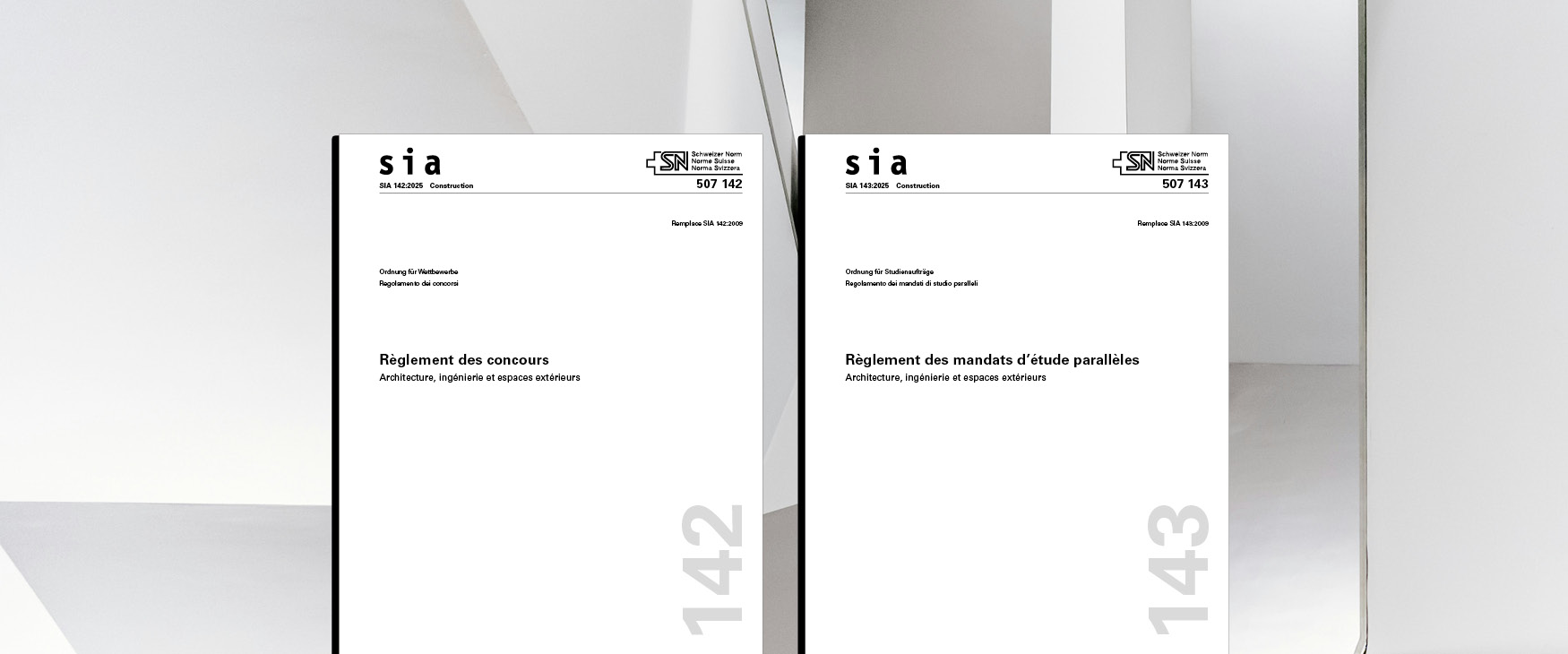L’évènement «Réinventer»: des paillettes aux oubliettes?
Dix ans après «Réinventer Paris», les "Appels à projets urbains innovants" révèlent les limites d'un modèle où communication et marketing priment sur l'expertise, au détriment de la qualité urbaine et du rôle des administrations.
Les Appels à projets urbains innovants (APUI) essaiment en France depuis 10 ans à la suite du très médiatique «Réinventer Paris» (lire l'article: Réinventer Paris: marketing urbain ou réels projets?.) Présentés par les élus à leur initiative comme une rupture avec des pratiques datées (loi MOP), les APUI constituent un approfondissement de dynamiques antérieures: foi dans l’innovation collaborative et la «destruction créatrice» pour répondre aux enjeux contemporains, cession du patrimoine public face à l’austérité, développement de l’urbanisme négocié et rôle croissant des promoteurs immobiliers…
Des groupements composés d’opérateurs immobiliers, de concepteurs, de bureaux d’études et d’exploitants, mis en concurrence, soumettent des projets intégrés (programmation, écriture architecturale, charge foncière, innovations constructives et environnementales) pour espérer obtenir des fonciers.
Le grand nombre de sites tout autant que le caractère médiatisé de ces consultations engendrent une émulation, de multiples réponses. Par la cession simultanée de bouquets de sites, les organisateurs font évènement, poussent de nouvelles idées : intégration des preneurs dans la définition des programmes, construction bas carbone… Autrement dit, les «Réinventer» (Paris, la Métropole du Grand Paris, la Seine…) constituent des instruments d’influence visant à impulser un changement des pratiques. Pour convaincre, les propositions sont marketées au risque d’une aterritorialisation des projets. Les administrations disposent quant à elles d’un temps limité pour contre-expertiser les offres.
Près de dix années après « Réinventer Paris », les paillettes semblent ternies. Si plusieurs projets sont aujourd’hui livrés, d’autres sont abandonnés. L’opérationnalisation des projets constitue une épreuve de réalité où l’innovation promise fait souvent office de variable d’ajustement face à la survenue d’aléas. Cette faible anticipation peut être reliée au caractère médiatique des consultations. En effet, dans le cadre de la sélection des sites et de l’analyse des projets, l’appréciation techniquement étayée apparaît en retrait (sélection de fonciers pollués, faible prise en compte des procédures administratives conditionnant la réalisation des projets, programmes et prix de sortie non adaptés aux territoires…).
La question demeure néanmoins celle des effets produits. Les «Réinventer» ont contribué à mettre à l’agenda de nouvelles thématiques, des associations se sont professionnalisées (urbanisme transitoire…), des entrepreneurs «militants» ont émergé (construction bois, foncières commerciales solidaires). Ainsi, alors que les commentateurs se sont concentrés sur les images et les projets, un effet central des «Réinventer» est à chercher dans la recomposition des pratiques avec le renforcement des opérateurs immobiliers en tant qu’agrégateurs de compétences pléthoriques et que prescripteurs de concepts à la pertinence incertaine. L’aura médiatique et le renom occupent en particulier une place croissante dans l’activité au détriment de l’expertise. Cette événementialisation de la fabrique urbaine s’opère au risque d’une affiliation marchande croissante de l’innovation et de l’architecture, d’un affaiblissement des administrations dans leur capacité à élaborer des cahiers des charges et contre-expertiser des propositions bien souvent nébuleuses.
Yoann Pérès est urbaniste, chercheur associé au Laboratoire Techniques, Territoires, Sociétés (LATTS) et auteur d’une thèse doctorale sur les « Réinventer ».