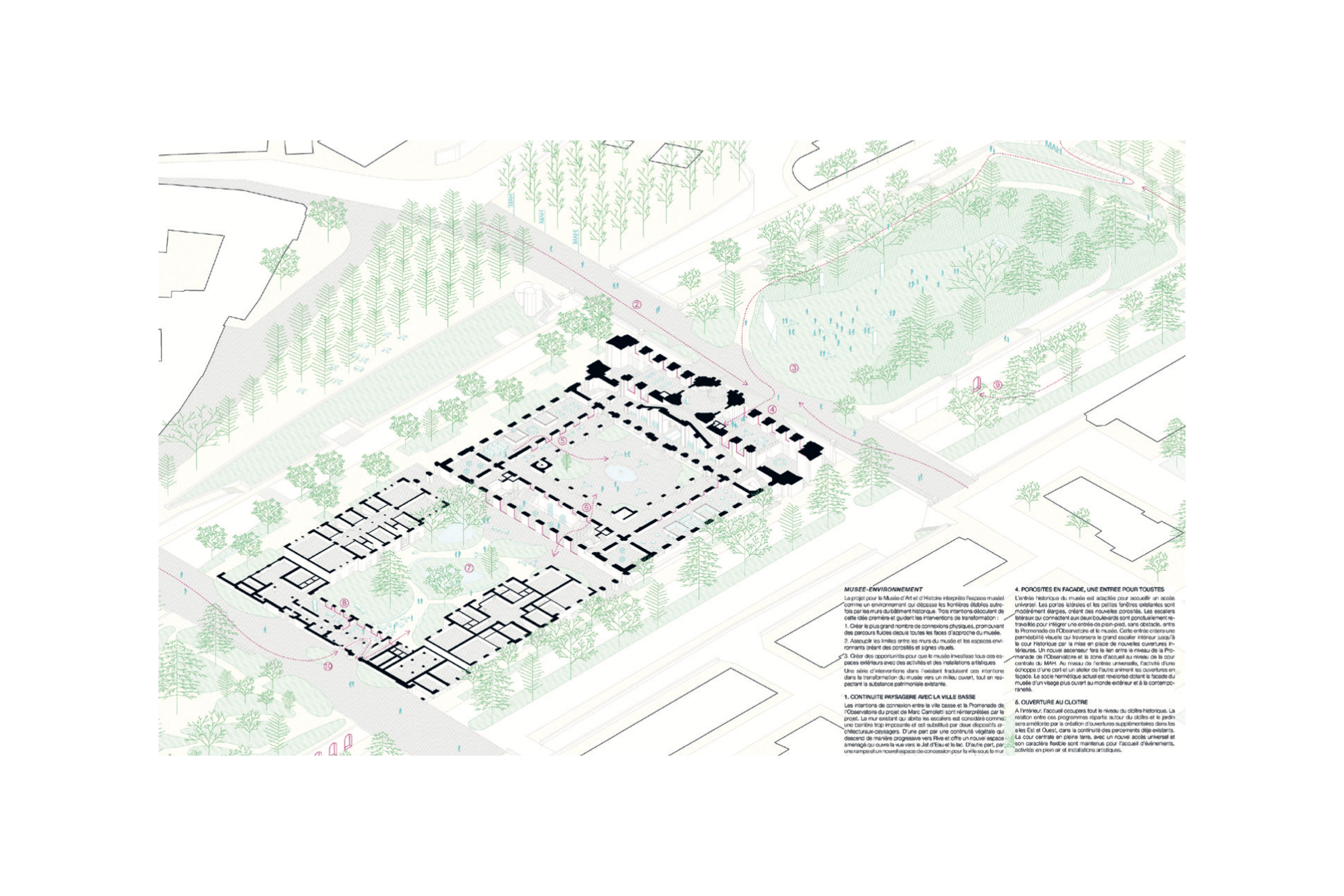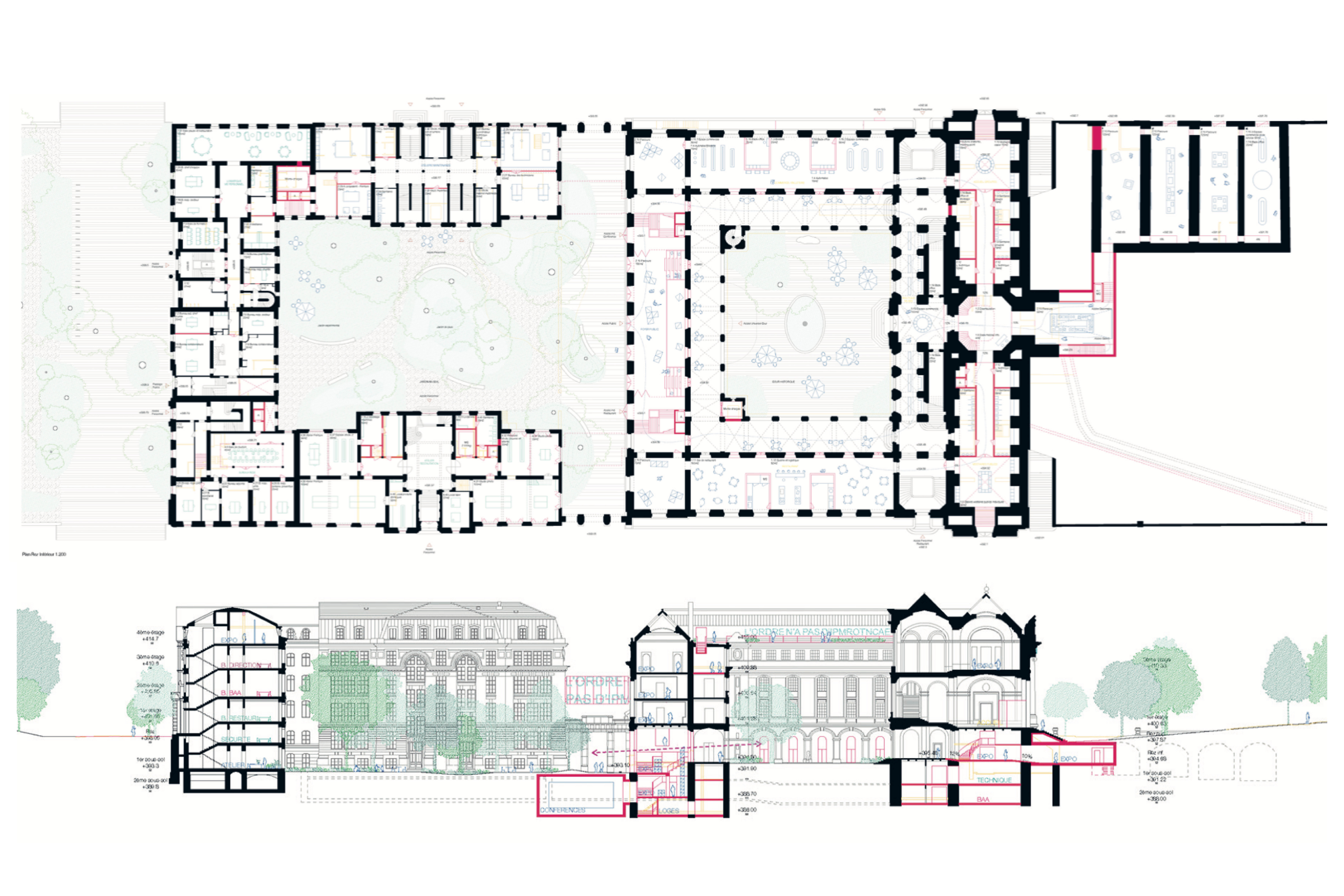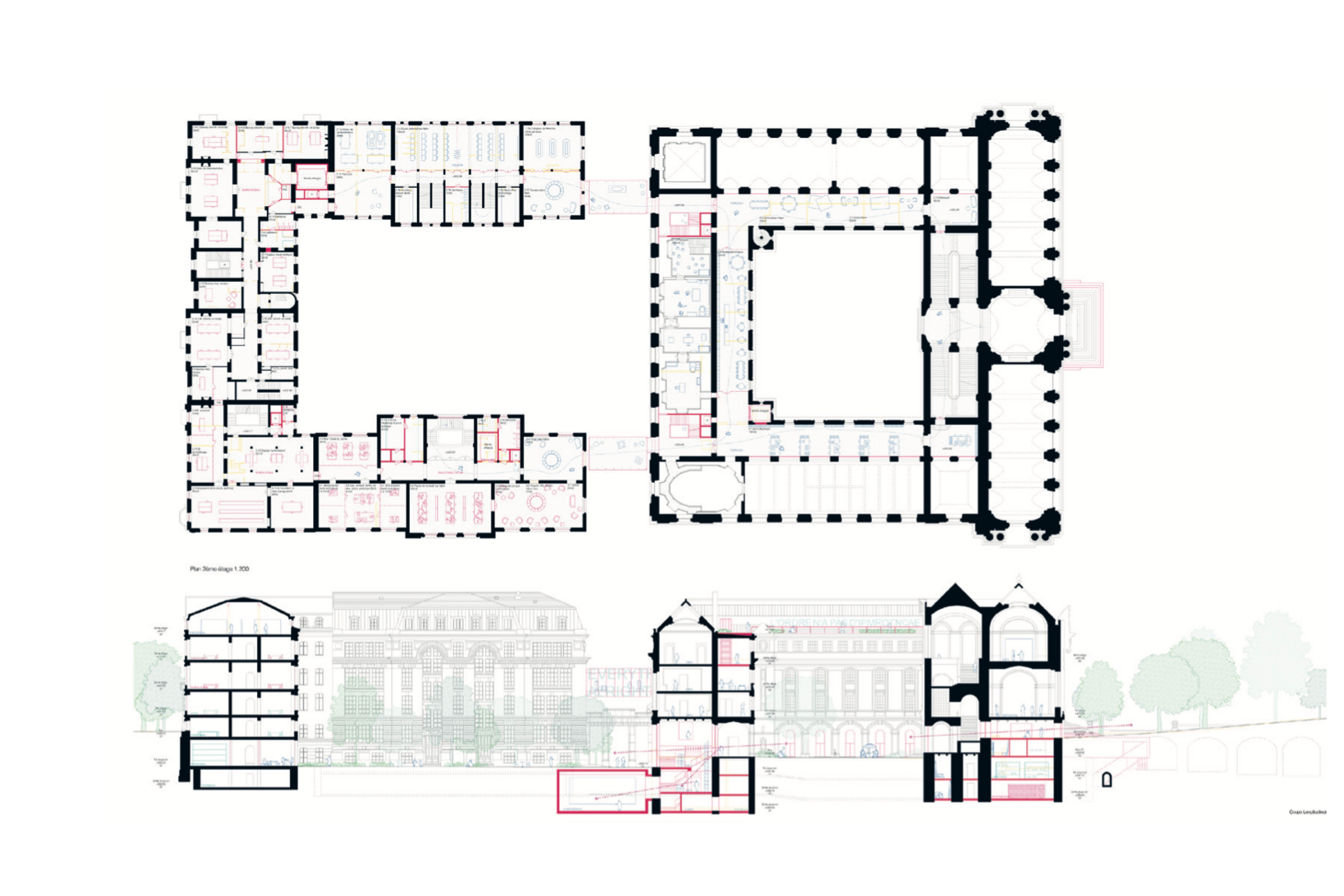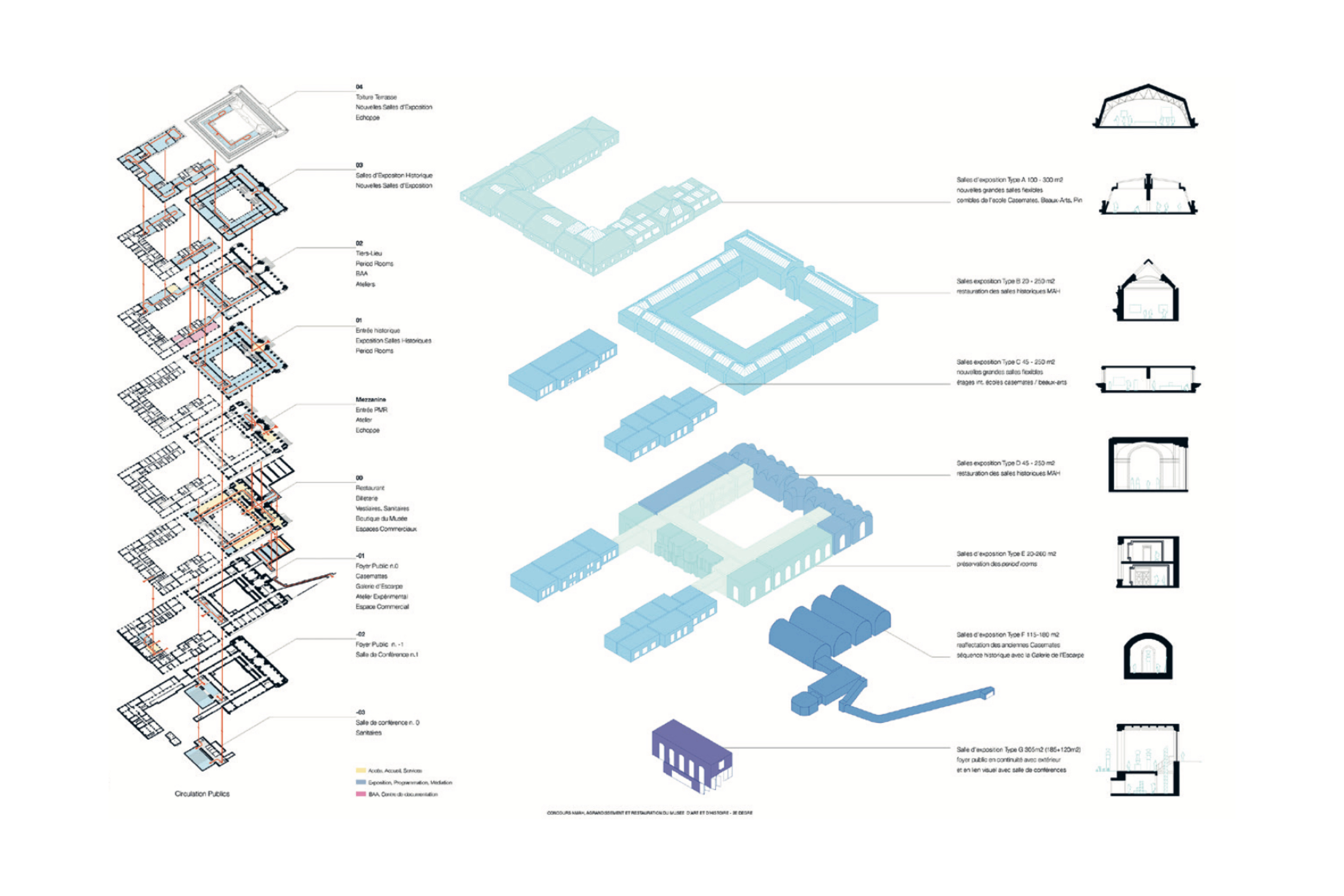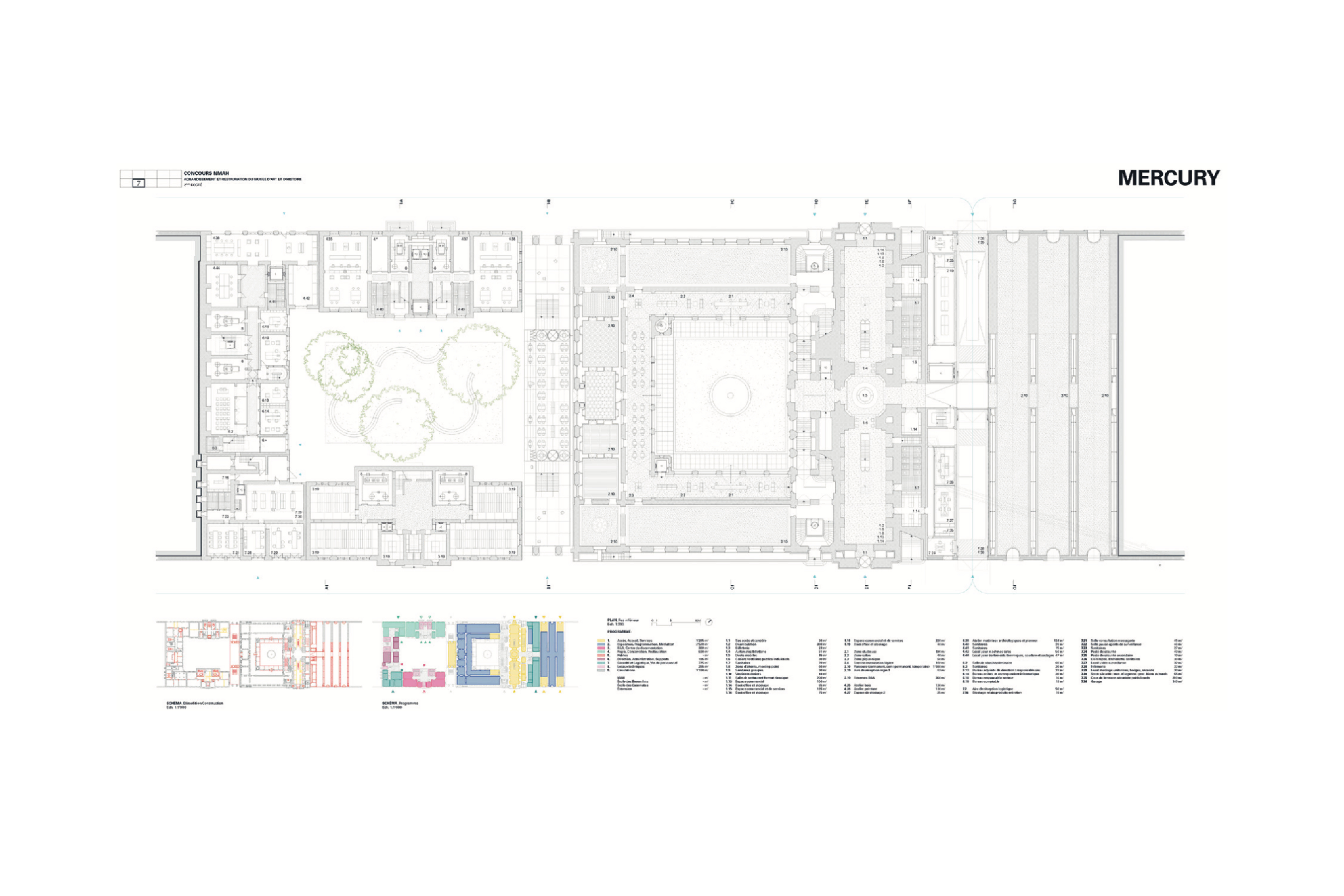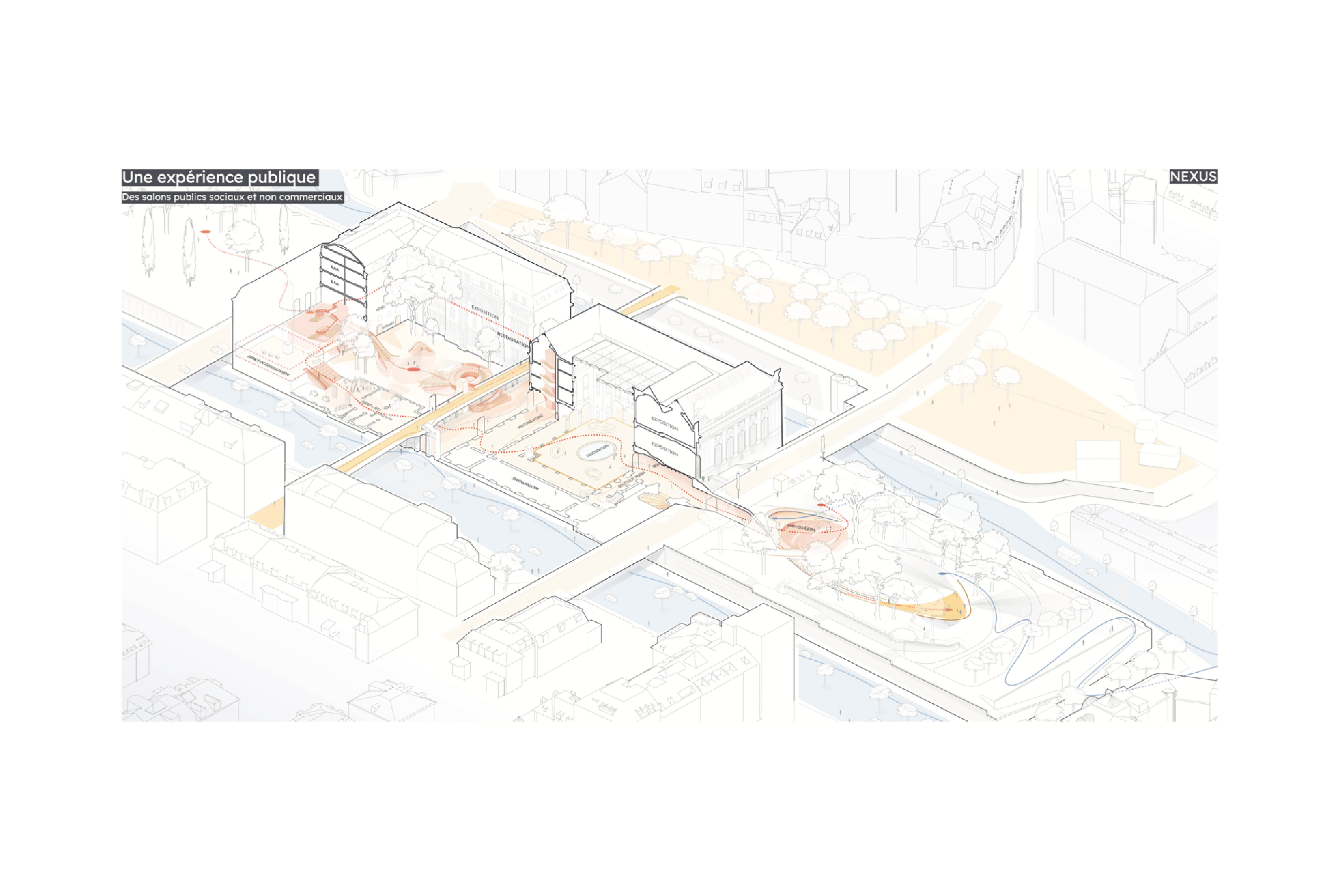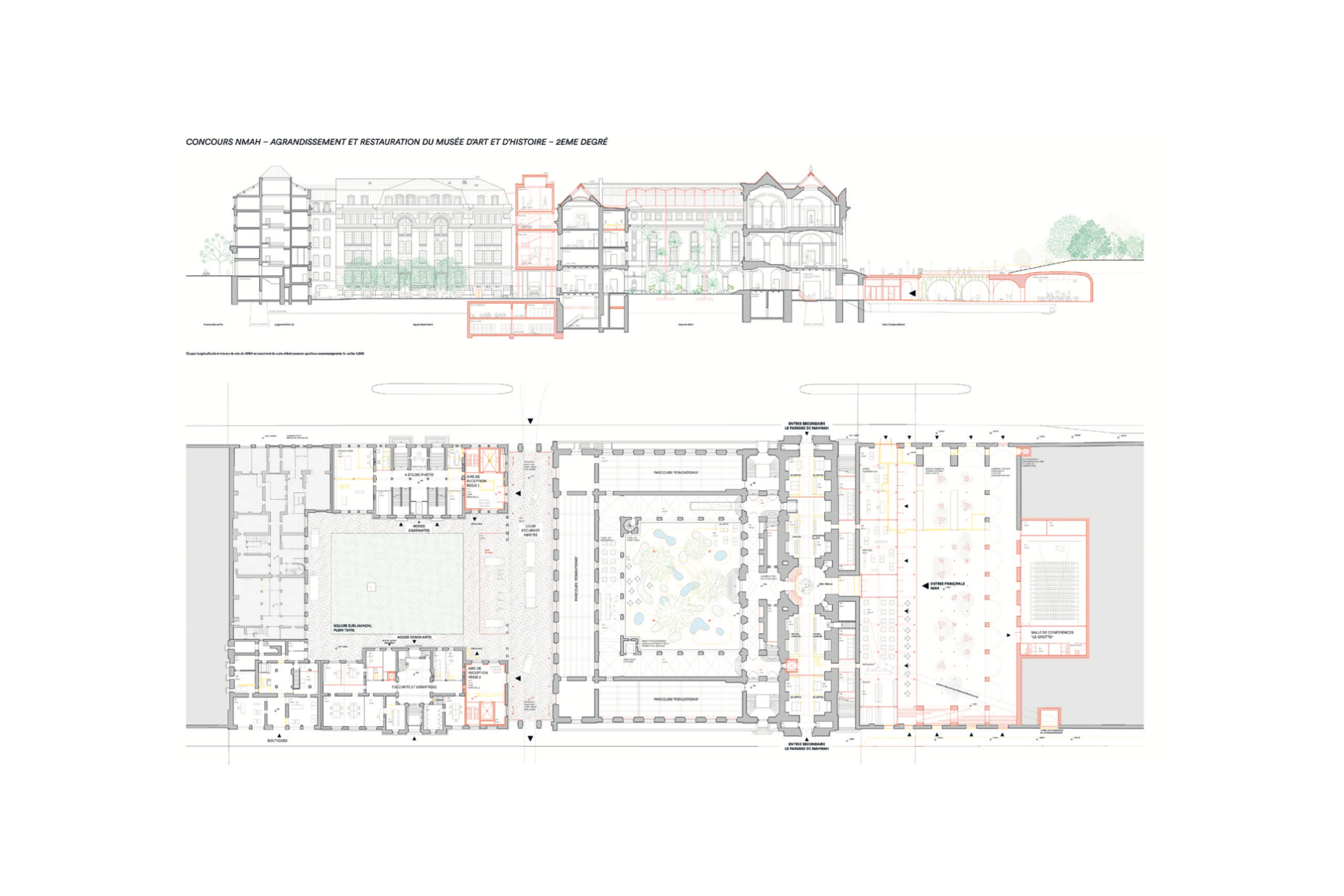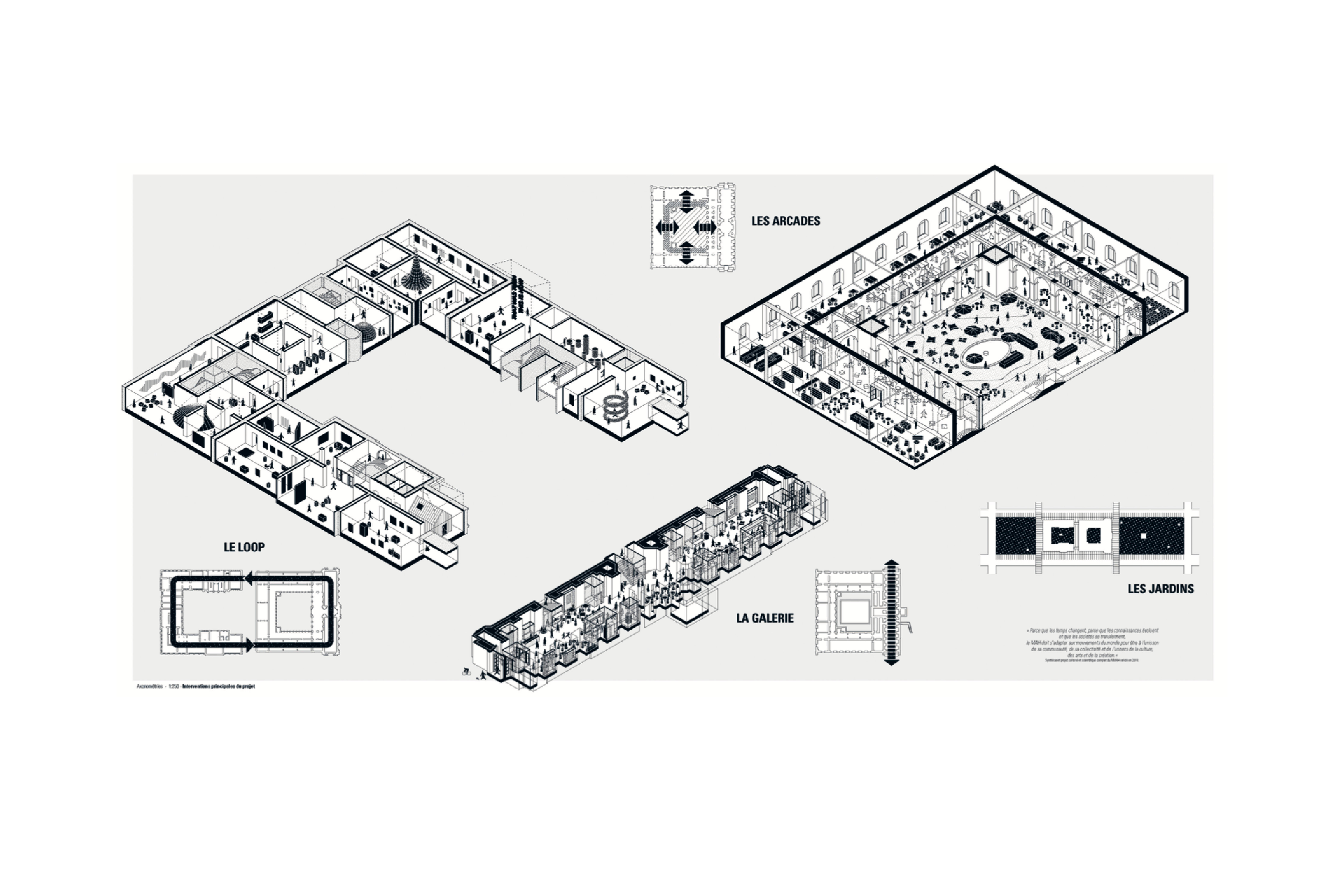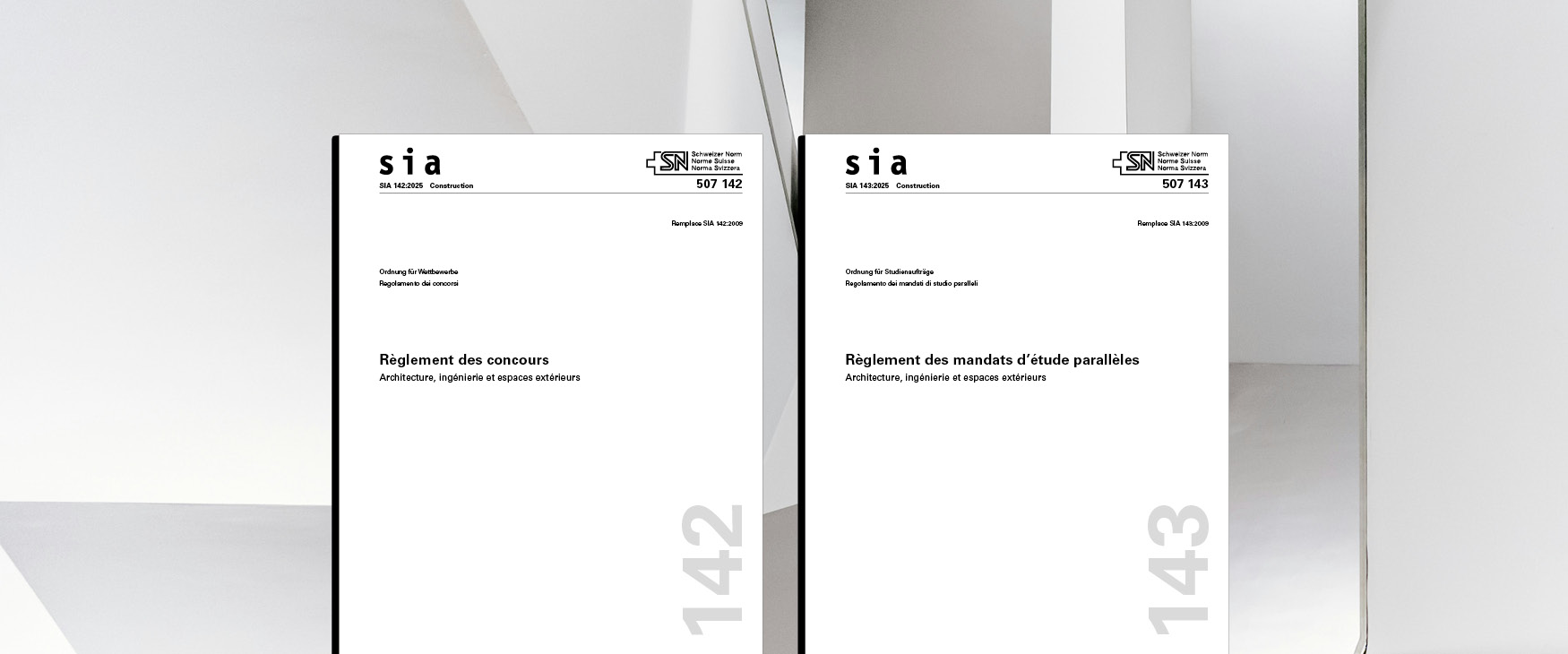Concours MAH Genève
La promesse d’un musée-environnement
Le projet lauréat du concours pour le MAH est celui qui propose de construire le moins. Fruit d’une patiente analyse des surfaces disponibles, la proposition réagence, reconfigure, met en relation et invente, peut-être, un nouveau type d’environnement muséal.
«C’est le projet que nous attendions». Quand Pauline Nerfin, présidente de la section genevoise de Patrimoine suisse (PsGe), fait cette déclaration à la RTS, on imagine le soulagement général. Il aura fallu neuf années pour entendre cette petite phrase – une forme de validation publique que le patrimoine, cette fois, ne s’opposera pas à la transformation du Musée d’art et d’histoire de Genève (MAH).
Le 28 novembre 2016, les électeurs de la Ville de Genève refusaient à 54% le projet de transformation et surélévation de Jean Nouvel, après un débat explosif. PsGe avait alors combattu farouchement la transformation et surtout la surélévation du musée néoclassique conçu par Camoletti en 1910, dénonçant une atteinte au patrimoine. Dans son argumentaire de campagne, la section proposait un contre-projet, élaboré par Marcellin Barthassat: étendre le musée non pas à la verticale, mais à l’horizontale. Vers l’ouest, en exploitant les surfaces de l’ancienne école des Beaux-Arts et de l’école Casemates, toutes deux situées dans l’îlot voisin; vers l’est, en suggérant de creuser sous la butte de l’Observatoire, ce grand parc adjacent que Camoletti aurait souhaité modeler comme un jardin adjacent au musée. Ce contre-projet est pratiquement devenu le cahier des charges du concours, le collège d’expert intègre deux membres de la section, et c’est le projet qui touche le moins au bâtiment de Camoletti, Umwelt, qui est sacré lauréat.
A-t-on donné trop d’autorité aux défenseurs du patrimoine? Quand la journaliste demande à Pauline Nerfin si l’on risque de manquer le «geste» architectural qu’on attend de ce type d’opération, elle répond d’emblée que le geste a déjà été effectué, en 1910. La force de ce projet, c’est de l’avoir compris.
Pas question de buter la butte
Les 48 puis 10 concurrents en lice de ce concours ouvert à deux degrés devaient résoudre une équation complexe. Car depuis 2016, la protection de la butte de l’Observatoire, ce petit carré de végétation situé en pleine ville, était devenue un enjeu, cette fois pour la protection de l’environnement. «Avec cette extension, on va buter la butte», déclarait le Vert Alfonso Gomez en plein débat sur le crédit d’ouvrage. Préserver la pleine terre était donc un enjeu prioritaire du concours et Pauline Nerfin s’étonne que peu de concurrents l’aient compris. Lors du jugement du premier degré, le collège d’expert a dû se fixer une ligne de démarcation et exclure les projets qui s’étendaient en sous-sol au-delà de la quatrième casemate. Les casemates sont ces abris voûtés liés aux fortifications, qui ont été aménagées au 18e siècle sous la butte, côté boulevard Emile-Jacques-Dalcroze. Leur situation invitait naturellement à les intégrer au concept du futur complexe muséal. L’équipe conduite par Made In, par exemple (3e prix/3e rang), propose de les prolonger jusqu’au boulevard de la Confédération, de l’autre côté de la butte, donnant ainsi une nouvelle adresse au musée.
Si l’on ne peut ni surélever ni creuser sous la butte, où étendre le musée? En reconvertissant toutes les surfaces disponibles. Le périmètre d’intervention intégrait en effet l’ensemble de l’îlot adjacent, jusqu’au bâtiment en L qui le clôt, sur la Promenade des Pins, actuellement occupé par quelques appartements. La plupart des grandes agences de la place n’ont pas osé s’aventurer aussi loin, préférant rassembler les surfaces dédiées au musée vers son entrée. Les appartements (certains reconvertis en bureaux) sont propriétés de la Ville de Genève qui devrait déloger sans risque ses quelques occupants.
MEP ou concours?
Étant donné l’incertitude quant aux espaces à mobiliser, aurait-il fallu préférer ici des mandats d’étude parallèles? Peut-on demander aux équipes qui travaillent (bénévolement, pour 38 d’entre elles) de trancher sur cette question, et donc de prendre un tel risque? Cruel pour les équipes en lice, le concours ouvert présente toutefois l’avantage d’offrir au jury une palette de solutions qui, toutes ensemble, désignent la bonne solution. En l’occurrence, certains projets primés semblent avoir montré la voie: citons celui de l’équipe menée par Dürig Architekten, Then & Now (2e rang/2e prix), proposant un parcours de visite en boucle traversant l’ensemble des surfaces du carré de Camolleti et de l’îlot, en une longue et passionnante enfilade de pièces ; ou encore celui de l’équipe conduite par Wulf Architekten (établis Stuttgart, vivant au contact du fameux projet de musée «urbain» conçu par James Stirling) qui imagine avec Nexus (5e rang/5e prix) un véritable «campus» muséal connecté à la ville adjacente et au parc.
Les différents projets en lice ont amené le collège d’expert à bien saisir celui des lauréat, le seul qui propose radicalement de ne rien construire en sous-sol, ou presque. Seules la livraison et une petite salle, dédiée à la projection de films, sont aménagées sous la butte. Le projet lauréat répond également à l’autre enjeu majeur du concours, celui de relier à la ville le MAH, cette forteresse juchée sur une sorte de promontoire difficilement accessible. L’équipe y parvient en partie grâce à sa proposition paysagère (Atelier Plum). Celle-ci consiste à rassembler les poches de plantations adjacentes afin de former un grand espace végétal comparable au parc des Bastions (65’000 m2) et de tirer une trame de plantations harmonisée avec les projets de végétalisation en cours de Rive et du Bastion Saint-Antoine. En conservant la pleine terre sur la butte de l’Observatoire et en désimperméabilisant les cours, le projet parvient à tripler le taux de canopée.
Réinventer le musée
Avec le choix du projet Umwelt, le jury minimise probablement les risques d’opposition. Mais il soulève un défi, celui que la direction du MAH propose de relever : réinventer l’expérience muséographique. Depuis le covid, explique Marc-Olivier Wahler, le directeur du MAH, les musées sont en baisse de fréquentation. «Tout le monde pense que les musées vont devoir évoluer, mais personne ne dit comment», estime-t-il.
Et il est vrai que le musée, en Suisse, ne se réinvente pas. Malgré les tentatives proposées dans des concours prestigieux, ils finissent généralement par ressembler à des coffres-forts hermétiques – white cube dedans, white box dehors. Dernier en date, le Kunstmuseum de Berne reproduit ce standard, en sacrifiant l’ancienne annexe réalisée par l’Atelier 5 dans les années 1970. La raison est à chaque fois la même: devant la responsabilité de réaliser un projet de plusieurs centaines des millions et par crainte des oppositions, le choix des jurys se porte systématiquement vers le projet le moins risqué, et donc le plus consensuel, celui qui reproduit le mieux ce que l’on sait faire.
Umwelt pourrait changer cette tradition. En misant tout sur l’existant, la proposition de Cabinet ne cherche pas à adapter les édifices aux musées que l’on connaît, elle impose d’adapter l’idée même du musée à l’existant. Pensé comme un «milieu» muséographique, le projet lauréat donne ainsi une réponse convaincante à l’espace «multifréquence» que Marc-Olivier Wahler aimerait déployer au MAH. Ce concept «additionnel et non hiérarchisé» intègre l’ensemble des espaces dans la relation avec les œuvres, pas seulement les salles d’exposition («sous douane»), mais aussi les espaces «hors douane»: boutiques, escaliers, restaurant, abords et extérieurs, etc. Le directeur envisage de créer une expérience muséale complète, qui intègre d’autres relations à l’art que la contemplation silencieuse que l’on connaît. En 2008 déjà, il avait imaginé des chambres d’hôtel au-dessus du Palais de Tokyo, à Paris (baptisé Everland). Le concept multifréquence autorise tout: «Si on veut s’arrêter, si on veut boire un verre, si l’on veut dormir, si on veut faire toute autre chose, danser, tout ça, ça doit être possible dans un musée, sans faire de compromis sur la manière de présenter les œuvres ni la manière de recevoir les œuvres.», lit-on sur le blog du MAH.
L'ODRRE N'A PAS D'IPMROTNCAE
Les journalistes qui demandent où est le «geste architectural» ne savent pas que le projet d’avant-garde, aujourd’hui, c’est celui qui ne construit pas. Umwelt est une contribution précieuse à l'Umbaukultur. Le projet démontre une fois encore que la conservation génère l’innovation. Sa radicalité consiste à tirer parti de tout ce que l’existant offre pour le reconfigurer. Sur les plans et les coupes, une poignée d’interventions (en rouge) suffit à reconfigurer complètement les espaces: deux passerelles de liaison, quelques escaliers supplémentaires, des sous-sols réaménagés, et c’est tout. Le projet travaille également en jaune (suppression): les fenêtres du rez-de-chaussée sont transformées en portes, de manière à rendre les façades poreuses et multiplier les relations entre les salles, les cours, le parc. Ce geste simple, répété en maints endroits, garantit l’accessibilité aux PMR. Quant au parc de l’Observatoire, il est simplement terrassé de manière à créer une pente douce descendant vers l’entrée du musée – que l’on a comparé au très populaire parvis du Centre Pompidou à Beaubourg, version végétale.
Ce qui fait la force du projet n’est pas un geste sculptural ou une image forte; elle tient dans les relations spatiales, les porosités entre les cours, une circulation libre et ce long parcours en enfilade rythmé par des espaces changeants, des respirations et différents types d’usages, notamment dans les volumes sous toiture, où l'on tire parti de leurs géométries singulières pour créer des ambiances spécifiques à chaque salle. L’équipe est également la seule à avoir proposé d’employer les terrasses (actuellement inexploitées), permettant de créer un restaurant et des vues panoramiques sur la ville. Le projet, selon la présidente du jury Ludovica Molo, permet de «redécouvrir des espaces qu’on ne soupçonnait pas».
Après une longue gestation, le projet du futur MAH ambitionne de réaliser un «écosystème créatif intégré au tissu social de la Ville», ce que les pôles muséaux de Zurich et de Lausanne ne sont pas parvenus à atteindre, pas encore. Mais il s’agit encore d’une promesse, et pour la réaliser, les architectes devront être fermes sur leurs principes, souples dans la mise en œuvre, en travaillant étroitement avec le musée, en admettant et permutant les usages au fil du développement du projet – comme le suggère l’œuvre d’Ann Veronica Janssens insérée dans l’une des vues du projet: L'ODRRE N'A PAS D'IPMROTNCAE.
Toutes les planches et les résultats du concours sont disponibles sur competitions.espazium.ch
Agrandissement et restauration du Musée d’Art et d’Histoire Genève
1er rang «Umwelt»
Cabinet Fanny Noël Diogo Lopes Architectes Atelier Plum AFRY Suisse Caeli Ingénierie
2e rang «Then & Now»
Dürig Neuland ArchitekturLandschaft Muttoni Partners Ingénieurs Conseils Tropeano Architekten Amstein + Walthert
3e rang «Mercury»
Made in Maurus Schifferli Landschaftsarchitekt ZPF Ingenieure Tecnoservice Gartenmann Engineering DVCI
4e rang «Eurydice»
Schmidlin Architekten MOFA studio Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure Silke Langenberg Studio Blomen Amstein + Walthert Kontextplan
5e rang «Nexus»
wulf architekten MAP Monnier architecture du paysage Thomas Jundt ingénieurs civils
6e rang «L26IE8NS»
Goutal et Clément Architectes Project BASEPerreten & Milleret
7e rang «Sans titre, 2024»
SAAS Yellow Office Dr. Neven Kostic Atmos Lab CRconseil Sàrl Normalmap
8e rang «Papagena»
AAPA Atelier ADR Nicolas Fehlmann Ingénieurs Conseils
9e rang «Minerva»