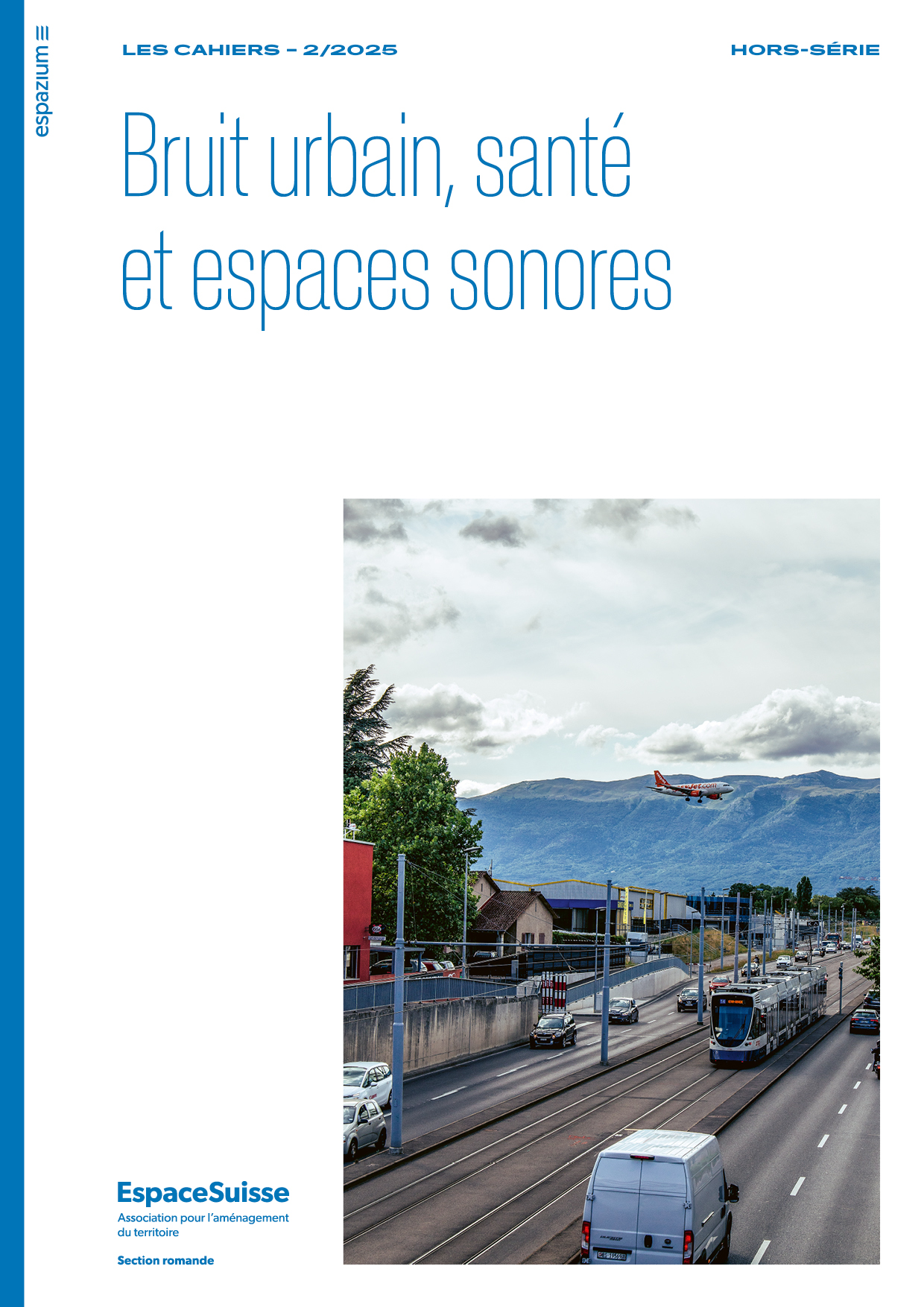Bruit urbain, santé et espaces sonores
Weitere Publikationen 2025 EspaceSuisse n°2
Ce nouveau hors-série des Cahiers d’EspaceSuisse – romande s’intéresse au bruit. Omniprésent mais invisible, il est devenu un enjeu de santé publique et de qualité de vie. Pour mieux s’en protéger, faut-il multiplier les normes contre le bruit ou composer avec lui, en imaginant des solutions créatives ? Ce Cahier explore les aspects juridiques, les effets sur la santé, ainsi que différentes mesures et solutions. Autant de pistes croisées qui pointent une même vision : faire que le bruit et les sons deviennent des indicateurs à part entière de la qualité de vie en milieu urbain !
Sommaire
Bruit: le subir ou composer avec?, éditorial de Marielle Savoyat
Le paradoxe de la révision des art. 22 et 24 de la loi sur la protection de l’environnement, Sophie Ribaut
La densification qualitative vers l’intérieur et la protection contre le bruit sont des enjeux indissociables. Les nombreux dépassements des valeurs limites d’immission (VLI), seuil au-delà duquel le bruit est nuisible pour la santé, sont notamment la conséquence d’une mise en œuvre lacunaire de la loi sur la protection de l’environnement. En Suisse, environ un million de personnes, soit une sur sept, sont exposées à de telles nuisances; 90% d’entre elles vivent dans des villes et des agglomérations. La protection contre le bruit n’est pas un luxe, mais un droit. En 2021, la Commission fédérale pour la lutte contre le bruit a recommandé d’abaisser les valeurs limites jugées obsolètes, à la lumière d’études scientifiques soulignant les impacts négatifs du bruit du trafic sur la santé. Or – et c’est là que réside le paradoxe – en septembre 2024, le Parlement a décidé d’assouplir les normes de protection contre le bruit, allant jusqu’à permettre de construire sans devoir respecter les valeurs limites applicables. Ces modifications entreront en vigueur au printemps 2026. Focus sur les causes de cette révision et ses implications.
L’assainissement du bruit en Suisse: focus sur la santé, les coûts économiques et l’aménagement de l’espace sonore, Béatrice Balsiger, Sam Lanners
En Suisse, pendant la journée, une personne sur 7 (1.1 million de personnes) est exposée, à son domicile, à des nuisances sonores dues au trafic dépassant les valeurs limites d’immissions fixées par l’ordonnance sur la protection contre le bruit. Pendant la nuit égale- ment, une personne sur 8 (1 million de personnes) souffre d’un bruit de circulation nuisible ou incommodant. En Suisse, le bruit engendre des coûts économiques considérables. En 2021, les coûts externes du bruit s’élevaient à environ 2.6 milliards de francs. Sur ce montant, environ 1.4 milliard correspondait à des coûts de santé et 1.2 milliard à des pertes de valeur de biens immobiliers. Le trafic routier est le principal responsable de ces coûts, à hauteur de 81%.
Bruit urbain et santé : vers une approche intégrative de la santé globale, Stéphane Joost, Philippe Voruz
L’environnement urbain façonne profondément notre quotidien, influençant des dimensions essentielles de la santé humaine. À travers les études menées dans plusieurs villes suisses, un constat s’impose: les caractéristiques de nos milieux de vie, en particulier l’exposition au bruit, ont un impact mesurable et spatialement structuré sur la qualité du sommeil et la somnolence diurne. Ces troubles, fréquents dans la population, ne sont pas de simples désagréments: ils sont associés à un risque accru d’accidents, à une diminution des performances professionnelles et à une dégradation générale de l’état de santé.
Ralentir pour préserver la santé de la population, Florence Germond
À Lausanne, depuis mi-septembre 2021, on circule à 30 km/h entre 22 h et 6 h du matin. Avant d’être mis en œuvre à l’échelle de la ville, le 30 km/h de nuit a été testé pendant deux ans sur les avenues de Beaulieu et de Vinet. Les résultats convaincants ont mené à la généralisation de la mesure à l’ensemble de la ville : une première en Suisse. Seulement trois mois après son déploiement, un premier bilan a montré que les usagères et usagers de la route avaient adapté leur comportement. La population vivant aux abords des rues et avenues concernées a ressenti une différence notable et appréciable. Les bénéfices sont documentés et étayés par plusieurs études scientifiques. Récit de la mise en place d’une mesure de santé publique pionnière en Suisse.
Des bruits et des sons dans l’image, Pascal Amphoux
«Lutter contre le bruit, c’est bien; promouvoir la qualité sonore, c’est mieux!» Cela fait 40 ans que l’on met en avant cet argument, 40 ans probablement qu’on l’ignore d’autant plus qu’on l’énonce... et que l’on continue donc à «lutter contre» le bruit – à construire des murs, dou-bler des fenêtres, mesurer des niveaux, à toujours plus légiférer, normaliser, contrôler. Autant dire à développer l’énorme marché des techniques de lutte contre le bruit – un peu comme si celui-ci existait en soi et était réductible à un simple niveau acoustique, mesurable et maîtrisable. Mais qu’est-ce donc que le bruit ? J’aime à le définir, simplement mais rigoureusement, comme « ce que l’on aimerait ne pas entendre » – et il conviendrait de prendre enfin acte du fait que cela n’a souvent rien à voir avec son intensité (une goutte d’eau peut réveiller un mort et un charivari refonder l’unité d’un groupe social). Comme nuisance, c’est-à-dire comme perturbation dans un écosystème sonore, il est inextricablement et fondamentalement dépendant de ses conditions d’émission autant que de réception et de propagation.