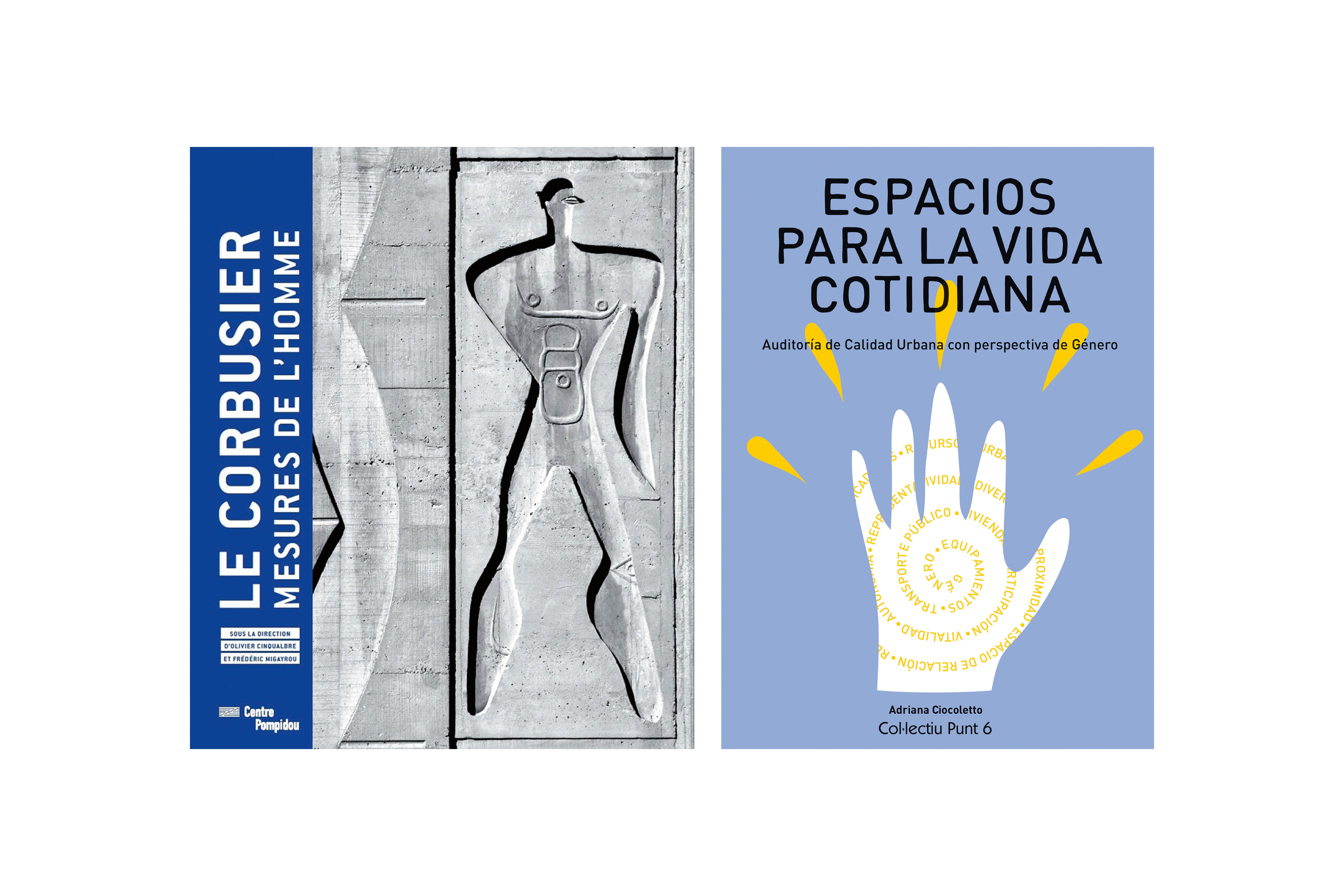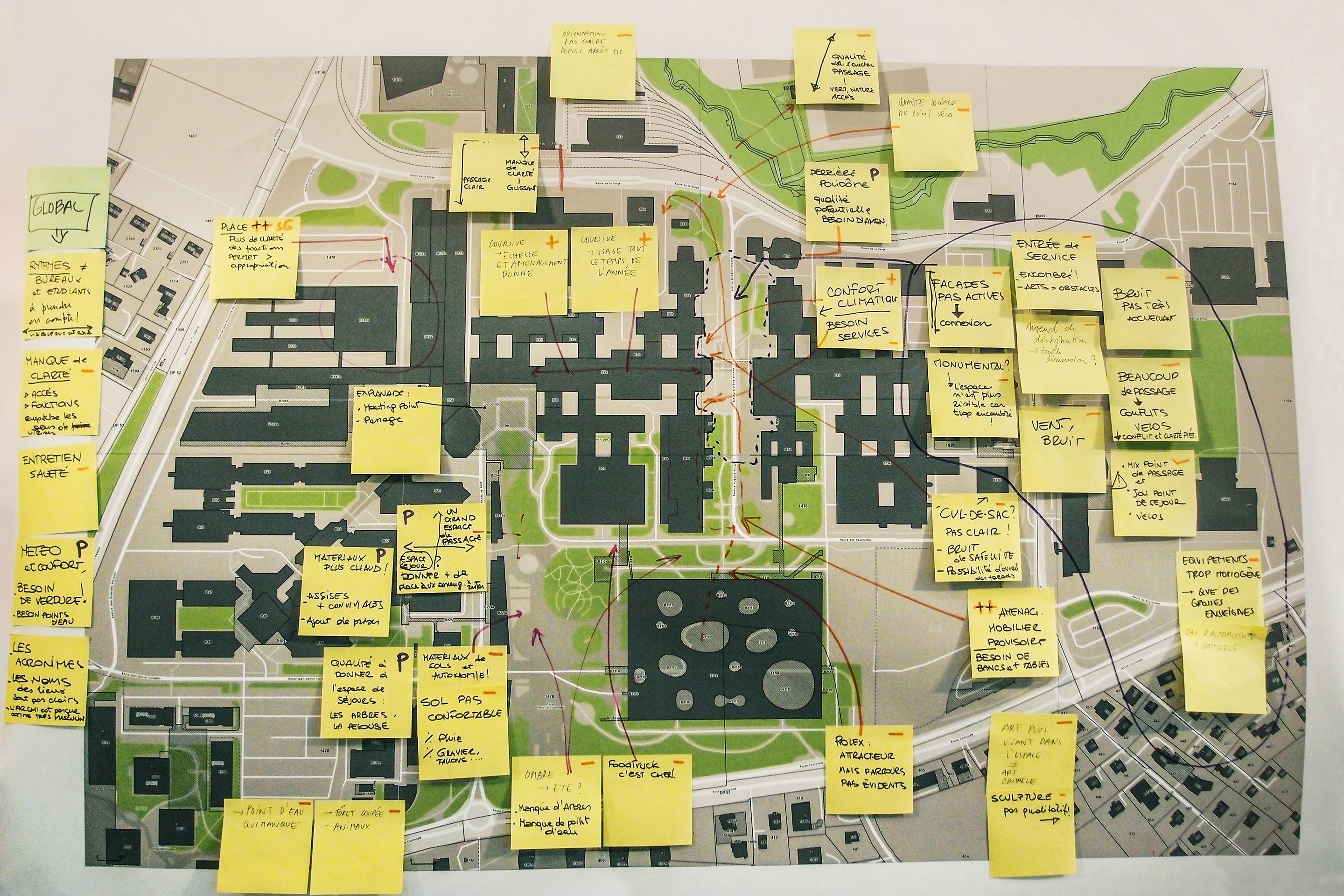Pour une ville pluriverselle au quotidien
Ménager plutôt qu'aménager
Comment penser la ville, non plus (seulement) sous le prisme de la «durabilité», mais en l’ancrant dans l’éthique du care, c’est-à-dire de la sollicitude, de l’inclusivité, du soin au quotidien? Depuis 2019, le groupe romand de l’association Lares milite activement pour la conception d’espaces publics pensés pour tout un chacun.
Qu’il s’agisse d’un feu vert trop court pour traverser un passage piéton, de se retrouver systématiquement en périphérie de la cour d’école, d’adopter des stratégies de contournement de certaines rues la nuit, ou de devoir adapter son parcours du fait de barrières architecturales, l’exclusion spatiale fait partie du quotidien des personnes qui ne correspondent pas au modèle du citoyen défini comme lambda. L’espace urbain structure nos interactions sociales et les usages que nous en faisons. En reflétant les dynamiques sociales de genre, il ne constitue pas un lieu de sociabilité et de liberté pour tou·x·tes. Conçu selon un modèle universel implicite – masculin, cis, blanc, valide, corbuséen –, il répond aux besoins d’un seul segment de la population.
En référence aux approches pluriverselles1, qui, à l’encontre de l’universalisme, reconnaissent la multiplicité des façons d’habiter le monde, la prise en compte de la diversité des expériences de vie quotidiennes et de la pluralité des besoins qui en découlent favorise une appropriation élargie des espaces urbains. Elle encourage le développement d’une ville qui promeut le relationnel, l’interculturalité, la solidarité et l’intergénérationnel.
Ce sont nos pratiques, mais aussi nos structures professionnelles qui pourraient évoluer à partir de la lecture du quotidien. Dans une société qui valorise avant tout les activités productives – bien et services rémunérés –, celles non rémunérées – soin, sollicitude et accompagnement des proches – peinent à trouver véritablement leur place dans l’espace urbain. Historiquement et majoritairement assumées par les femmes, ces tâches (souvent appelées «tâches reproductives» ou du care2) sont essentielles à la cohésion sociale. Elles structurent tant les déplacements que l’occupation de l’espace des personnes qui les assument (accompagnement des enfants, soins aux proches, courses, interactions de voisinage…) et ont été invisibilisées.
La ville moderne – théorisée dans la charte d’Athènes – a largement participé à cette invisibilisation. Le principe de «houzification/domestication», c’est-à-dire le fait de cantonner la sphère reproductive à l’espace domestique, découle, entre autres, de l’application massive du principe du zoning3. Aujourd’hui, plutôt que de restreindre la vie quotidienne à l’espace privé, il est essentiel de lui redonner une place dans la conception du projet en la considérant dans toute son ampleur et sa diversité, des rues aux quartiers en passant par les infrastructures publiques et par les projets territoriaux de grande échelle.
Une ville pensée à travers ce prisme est une ville des courtes distances, favorisant l’usage de la mobilité active et le vivre ensemble, en interaction permanente avec la multiplicité des vécus dans un espace dynamique. Dans les politiques publiques, cela se traduit entre autres par le concept de ville de proximité. Plusieurs cantons et villes suisses ont entrepris très récemment d’analyser de près les dynamiques territoriales des courtes distances pour répondre à la nécessité de réduire drastiquement l’impact environnemental des déplacements. Ce n’est donc qu’aujourd’hui, sous la pression des enjeux environnementaux et de santé, que ces réflexions émergent comme des priorités. Pourtant l’urbanisme féministe défend cette approche depuis les années 1970, proposant de sortir les activités associées au care de la sphère domestique avec pour objectif de déjouer l’oppression patriarcale.
L’analyse du quotidien comme méthodologie et pratique
Pour redonner une place à l’éthique du care dans nos villes, il est indispensable de mieux prendre en compte, dans nos méthodologies d’analyse et de conception, la diversité des expériences spatio-temporelles et leur dimension située4. Qui utilise l’espace urbain? Comment et quand? Qui s’y sent légitime, en sécurité, de jour comme de nuit?
À travers cette clé de lecture, réseaux de mobilité, places, rues, infrastructures et services sont analysés sous plusieurs critères transversaux. Par exemple, le critère d’autonomie permet de saisir, quelle que soit la taille, la diversité fonctionnelle, l’âge, ou les tâches de soin à réaliser, les possibilités perçues par chacun·e·x dans son environnement de vie en termes d’accès, de sentiment de sécurité et de confort. La représentativité est un autre critère central. Elle fait référence aux images hétéronormées, androcentrées et occidentalocentrées véhiculées par les espaces urbains au travers des noms des rues, de la signalétique, de la publicité, des œuvres d’art qui s’y trouvent, effaçant ou surreprésentant certains groupes sociaux. Loin d’être figés, ces critères d’analyse s’adaptent aisément aux phases et au contexte des projets.
Dans la pratique, plusieurs outils participatifs permettent de recueillir la parole des utilisateurice·x·s: marches exploratoires, ateliers ou entretiens. En visant une représentation la plus fidèle possible de la multiplicité des vécus des personnes concernées par le projet, ces méthodes contribuent à remettre en question le principe d’universalité d’usage. Un principe qui se traduit trop souvent par un accaparement spatial par des groupes dominants.
Dans le travail de conception, la relation entre parcours rapides, fragmentés ou alternatifs et espaces récréatifs et de service, directement liés à la charge du care, devient un élément central. Il s’agit d’assurer une visibilité spatiale équilibrée entre les différentes activités, en évitant de donner systématiquement une place centrale aux activités pratiquées par une seule catégorie sociale. Dans le cas des préaux, par exemple, les jeux de ballon5. On cherchera donc à concevoir des aménagements suffisamment indéterminés, ne présupposant pas un seul usage, et participant à l’émergence d’un continuum d’activités de différentes natures, dans un même lieu, accessibles à différents groupes et réparties dans le temps.
Enfin, travailler sur l’accompagnement à la mise en œuvre et à la gestion de ces espaces contribue à une appropriation plus égalitaire des installations et aide à pérenniser la présence de groupes traditionnellement absents.
Des leviers pour changer les pratiques de la production spatiale
L’espace urbain n’est pas le seul lieu de reproduction de l’ordre social du genre. Interrogées au prisme de la quotidienneté, nos structures professionnelles – bureaux d’architecture, d’ingénierie, de paysage ou d’urbanisme – laissent peu de place au quotidien et à la conciliation entre activité professionnelle et privée ou vie familiale. Écarts salariaux persistants, absence de congé parental, injonction au plein-temps masculin, entre autres, témoignent du cadre organisationnel prépondérant. Organisées de manière pyramidale, ces structures sont peu propices à une remise en question d’une vision encore largement fondée sur un modèle unique et universel de l’espace.
Pourtant, il existe en Suisse des alternatives organisationnelles basées sur d’autres valeurs qui mettent au centre les préoccupations liées à la conciliation entre quotidienneté du personnel et exigences de productivité de l’entreprise. En flexibilisant notamment les emplois du temps du personnel (congé parental, facilité des congés pour maladie d’enfants), elles prennent en compte une partie des tâches du care. Pour y arriver, ces entreprises s’organisent souvent autour de la cogestion et de la codécision6.
La société coopérative reste peu fréquente dans le secteur de la conception et de l’aménagement. Quelques bureaux ont cependant déjà franchi le pas en Suisse romande7. Cette forme organisationnelle permet notamment une meilleure prise en compte de la diversité des perspectives au sein d’un groupe au travers d’un processus décisionnel plus horizontal. Enfin, les nombreux collectifs émergents8, portés par une nouvelle génération, incarnent une volonté forte de transformation. Juridiquement souples – associations, sociétés en nom collectif, consortiums… –, ils privilégient la création en commun, une gouvernance choisie, et, sous réserve d’une conscientisation collective, une attention plus fine aux questions de genre et de répartition du travail.
Gageons qu’une prise de conscience accrue des enjeux sociaux du care au sein des bureaux enrichira les démarches de conception et les réalisations.
Nouvelles perspectives: bâtir une ville qui priorise le care
Aménager des villes sensibles aux enjeux de genre implique de remettre en question non seulement nos pratiques et nos structures professionnelles, mais également les choix et décisions politiques et économiques qui perpétuent une culture patriarcale de l’aménagement. Si la recherche académique offre aujourd’hui un corpus riche sur ces thématiques, l’un des défis majeurs du passage à l’action est d’intégrer une vision plurielle, peu standardisée et non fonctionnaliste des solutions d’aménagement. Cela permet d’éviter des réponses trop binaires qui ne visent qu’un seul groupe cible, par ailleurs peu homogène, «les femmes».
Adopter cet angle de la diversité du quotidien permet, tant dans l’analyse que dans la conception urbaine, d’insérer et de mettre en valeur le care au cœur de l’espace. Cette approche prend en compte l’évolution du profil des personnes en charge de ces tâches et ouvre la voie à un dépassement de la division genrée du travail.
Plus largement, une telle vision offre de nouvelles perspectives écosystémiques: une ville capable de questionner la productivité au profit de la réciprocité, la solidarité et la coopération. C’est dans ce sens que Joan Tronto a écrit en 2020: «Voici une humble requête aux architectes d’aujourd’hui et de demain: notre planète brisée a besoin d’une architecture du ménagement. Au-delà de ’ce que veut le client’, au-delà de l’architecture ’verte’ ou ’durable’, au-delà de construire un bel objet, nous avons dorénavant besoin d’une architecture qui s’acquitte de son rôle élémentaire dans notre responsabilité partagée de prendre soin du monde, une architecture qui soit sensible aux mérites de la réparation, de la préservation, du maintien de toutes les formes de vie et de la planète elle-même»9.
Cet article est le fruit d’un travail réflexif collectif mené au sein du Lares romand, en collaboration avec deux invitées, Karine Duplan, faculté des sciences de la société de l’Université de Genève, et Claire Logoz, professionnelle cofondatrice de la pratique multiple detritus. et Head of Design Research au laboratoire ALICE de l’EPFL.
Lares, association suisse fondée à Berne en 2006, œuvre à rendre visibles les inégalités de genre dans l’espace urbain, en proposant des leviers concrets pour les déconstruire. Elle promeut une planification sensible au genre, à toutes les échelles. Actif en Suisse romande depuis 2019, le collectif romand développe un large éventail d’activités: accompagnement de projets urbains, analyses critiques in situ, production d’outils méthodologiques, partage de bonnes pratiques, ainsi que des actions de sensibilisation et de formation.
Publications du Lares:
– «Apprendre par la pratique: vers une planification sensible au genre», EspaceSuisse – Cahiers de la section romande d’EspaceSuisse, 3/2023 Genre et espace public, pp. 12-26, 2023
– Projets de l’association Lares en Romandie. La question climatique et le genre dans l’espace public. FemInfo, 66/2024 – Genre. Espace. Climat., pp. 12-15. femwiss.ch
Notes
1. Le plurivers est souvent défini comme un monde où cohabitent plusieurs mondes. Les approches pluriverselles sont issues des études décoloniales latino-américaines et constituent une critique radicale d’un des fondements de la pensée occidentale moderne, l’universalisme.
2. L’éthique de care a été développée par la politologue féministe américaine Joan Tronto (née en 1952) qui théorise l’élargissement de l’éthique du care au-delà de la sphère domestique vers la sphère publique. Il n’existe pas de bonne traduction du mot «care» en français. Il est souvent traduit par «sollicitude» et/ou «soin», voire «ménagement».
3. Voir notamment les travaux de recherche de Dolores Hayden, Lidewij Tummers, Maria Mies
4. Approche basée sur la perspective d’un «savoir situé» développée par Donna Haraway. Contre la conception de l’objectivité scientifique fondée sur l’idée d’un savant «qui voit tout», la biologiste et philosophe défend dès les années 1980 que l’objectivité s’atteindra mieux en prenant conscience de la vision partielle et située des producteurice·x·s de connaissance.
5. Sur ce sujet, voir: Julie Riedo, «Yverdon-les-Bains, les espaces publics repensés à l’aune du genre», EspaceSuisse 3/2023; Bureau equal saree, «La cour d’école inclusive – Un guide de diagnostic et d’intervention dans une perspective de genre», equalsaree.org, 2017; voir également le projet de recherche de l’UNIL et de la Ville de Lausanne «préaux en tous genres», consultable sur le site – wp.unil.ch/preauxentousgenres et l’article de Sonia Curnier, «Les préaux, des espaces publics à réinvestir», TRACÉS 5/2025.
6. Le modèle du bureau suisse Metron AG, en place depuis 1974, constitue un exemple pionnier d’organisation alternative; l’entreprise compte aujourd’hui environ 150 collaborateurice·x·s.
7. Notamment: Labac, Idée 21, arge.co, baubüro in situ
8. Notamment: Le collectif Affluent, La Clique, En commun
9. Joan Tronto, «Caring Architecture», in Critical Care, Architecture and Urbanism for a Broken Planet, sous la dir. d’Angelika Fitz et Elke Krasky, MIT Press, 2020 – traduit de l’anglais par Joanne Massoubre et Martin Paquot, Topophile.